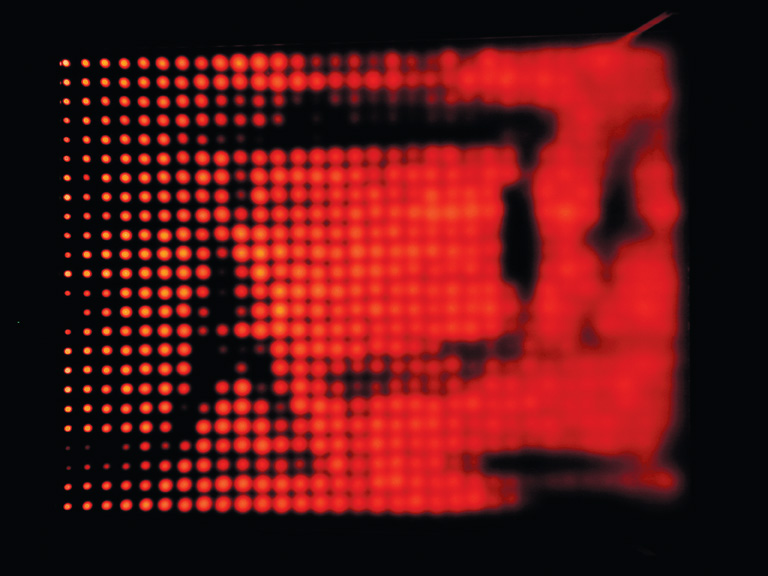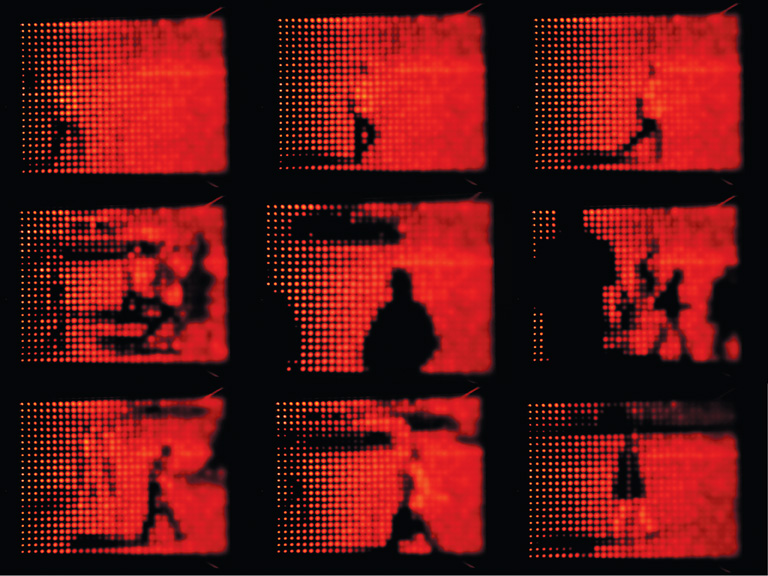[Summer 2008]
par Jean Gagnon
Mon père, comme plusieurs de sa génération1, était un fanatique de la photographie de famille. Tout était prétexte à faire des slides comme il disait. Nous vivions à Québec et il a ainsi créé, parmi les photos de Noël et de voyages l’été dans le Maine, une bonne documentation du Carnaval de Québec de la fin des années cinquante et du début des années soixante. Toujours est-il que les quarante et quelques carrousels de diapositives sont maintenant chez moi. Qu’en faire ? Bien sûr, les numériser va de soi. Mais selon les bonnes pratiques de conservation, cela ne me dispenserait pas de conserver les originaux dans une voûte appropriée. Et puis la numérisation elle-même n’est pas sans poser quelques enjeux : numériser en quel format, avec quel codec de compression ? Si sans compression, comme il serait recommandé, sur quel média stocker les images, ce qui pose la question du besoin d’espace disque pour le traitement et l’entreposage de gros fichiers ? Il y faudra sans doute une sorte de base de données pour s’y retrouver. Comment envisager l’obsolescence technologique, l’évolution des formats, des codecs, des systèmes d’opération, des machines, des logiciels ? À mon échelle, il me serait possible de répondre aux plus pressantes de ces questions et cela me coûterait du temps, des efforts certains et des frais en conséquence. En extrapolant, on pourra imaginer aisément la problématique et les coûts que devront assumer les grandes collections, les archives ou les cinémathèques.
L’évolution récente des technologies numériques nous le rappelle sans cesse, notre monde devient de plus en plus évanescent, instable, variable et fluctuant quant à la conservation et à la préservation du patrimoine numérique qui se crée et, plus particulièrement, des œuvres d’art à composantes technologiques. Tous nous commençons à mesurer l’ampleur de cette tendance qui emporte beaucoup de nos présuppositions quant à l’authenticité des œuvres d’art, à leur provenance et à leur valeur d’origine. Bien sûr, depuis longtemps en photographie, en cinéma et en vidéo, cette remise en question des valeurs de stabilité de l’œuvre d’art a été posée. Mais dans la situation actuelle, même la production de pellicule est appelée à disparaître ou à devenir très onéreuse tandis que si on trouve encore des bandes vidéographiques, l’encodage des images et des sons est maintenant entièrement numérique. Ainsi, nous réalisons l’indépendance de ce qu’on peut appeler le contenu des supports et moyens technologiques ; en ce sens, le numérique fait bien décrocher l’image analogique de tout référent. Une fois numérisée, l’image est calculée et infiniment modifiable dans tous les aspects de son inscription.
Documentation et conservation matérielle face à la performativité des œuvres
Nous vivons bien un changement de paradigme remettant en cause notre désir de stabilité et de permanence. Dans le monde de l’art, la prégnance d’une notion comme celle d’aura, servie à toutes les sauces, nous rappelle que nous tenons encore aux valeurs d’originalité et d’origine attachées à un objet, sculpture ou peinture, que l’on veut préserver tel quel. Ainsi, on s’en remet à des stratégies passives de conservation telles que l’entreposage, le contrôle environnemental et le dosage scientifiquement jaugé de la lumière pour en minimiser les ravages. L’idéal serait de figer l’objet dans le temps et de faire cesser sa dégradation matérielle. Or cette utopie s’oppose notamment à la valeur d’usage de l’œuvre et Benjamin avait noté cette opposition de la valeur-culte de l’œuvre et de la valeur d’usage de sa reproduction. Mais ce désir d’immuabilité de l’objet d’art se révèle illusoire. L’évolution des pratiques de restauration face à l’authenticité de l’œuvre a dû se préoccuper de plus en plus de son contexte, en intégrant l’ensemble des documents, l’œuvre et l’artiste.
Si la tendance se maintient, si la production de travaux artistiques par des moyens technologiques promet de continuer sinon de s’intensifier, la conservation résidera de plus en plus dans cette documentation et dans les systèmes de documentation informatisés, ainsi que dans les stratégies de conservation matérielle, c’est-à-dire dans la prévision de l’obsolescence des technologies. Car je ne crois pas beaucoup, en ce qui concerne la conservation des œuvres d’art technologique, aux solutions miracles qui se prétendraient all encompassing. Les œuvres d’art sont souvent trop singulières ou diverses, variables et composites. Une approche cas par cas est donc requise dans l’état actuel des choses. Certains projets de recherche font avancer avantageusement la réflexion sur les enjeux et les défis de la conservation des œuvres à composantes technologiques; on pourra consulter notamment le site de l’Alliance de recherche DOCAM ainsi que le site des médias variables2. Le projet des médias variables avait notamment élaboré un questionnaire à soumettre aux artistes afin de saisir certains paramètres de l’œuvre, non pas tant sa fixité optimum que le degré de variabilité de ses composants (éléments visibles, moniteurs, écrans, appareils divers) et l’importance relative des « comportements » de l’œuvre (interactivité, réseautage, etc.).
Plusieurs chercheurs universitaires en histoire de l’art se penchent sur le riche champ de recherche que constituent la performance et son histoire; le performatif devient une catégorie répandue pour parler de certaines pratiques de l’art contemporain ou actuel : l’aspect procédural, l’effectuation et la ré-effectuation temporelle de l’œuvre, la définition de l’espace par des dispositifs techniques affectant la réception et la rendant mobile, active, participative, interactive, bref la variabilité dans le temps selon le degré d’implication des participants, des joueurs ou des spectateurs. Face à ces aspects performatifs, comment fixer l’œuvre ou saisir son authenticité ? Qu’est-ce que conserver les états successifs de telles œuvres ? Comment faire lorsque l’intention de l’artiste n’est pas garante de l’authenticité et que celle-ci ne réside en aucun sujet ?
Container, contenu et contexte
En 1951, Suzanne Briet causait une commotion dans le monde de la documentation dont on ressent encore les répercussions dans la pensée théorique de la science de l’information. Dans son fascicule de 48 pages intitulé3, elle introduisait l’idée de document comme agrégat de discours liés à l’usage des documents, l’idée que ces derniers sont des constructions sociales. Elle reprend la définition traditionnelle du document comme incarnation de la preuve, comme trace et elle lui donne plus d’extension en tant que tout objet concret, indice ou symbole préservé ou conservé dans le but de représenter, de reconstituer ou de prouver un phénomène physique ou intellectuel. La nature indicielle du document fait qu’il devient partie d’un réseau et qu’il pointe vers autre chose, vers d’autres documents notamment; à la limite, le système des renvois et des indexations n’a plus d’objet que l’emploi qu’en font les usagers.
Dans la science de l’information actuelle, les notions de container, contenu et contexte4 sont devenues des métaphores pour articuler le destin du document à l’ère du numérique, des bases de données et des réseaux. Cette distinction s’avère utile dans le domaine des systèmes numériques de gestion de l’information, car elle permet de rendre indépendant le contenu humainement déchiffrable (texte, son et image) des méthodes et des médias de stockage. Ainsi le contenu demeure inchangé, c’est ce qui est recherché, même si le container peut avoir été modifié.
L’idéal serait de figer l’objet dans le temps et de faire cesser sa dégradation matérielle. Or cette utopie s’oppose notamment à la valeur d’usage de l’œuvre.
Ce qui est certes valable pour des documents numériques ne l’est pas nécessairement pour des œuvres d’arts technologiques ou numériques ; celles-ci présentent plutôt une variabilité dans leurs rapports avec le container. Quelques exemples suffiront à illustrer comment la distinction du container, du contenu et du contexte s’articule. Prenons Zen for TV (1963) de Nam June Paik; le contenu était à l’origine la captation et la modification des ondes hertziennes par le téléviseur trafiqué à l’aide d’une bobine électromagnétique de sorte qu’une ligne apparaisse sur l’écran. Le container, un téléviseur du début des années 1960, doit-il être préservé tel quel ? Le jour où il ne fonctionne plus, est-ce acceptable de sauvegarder les apparences extérieures alors que la ligne est générée grâce à des effets spéciaux ? Si cette ligne n’est pas le résultat de la captation d’un signal, d’une onde, est-ce le même contenu ? Ici, un élément contextuel nous aidera à trancher : on sait que de son vivant, Paik refaisait ses œuvres anciennes et il n’hésitait pas à utiliser une technologie plus à jour, nous indiquant que, pour lui, les aspects conceptuels sont plus importants que la réalisation technique ou physique de l’objet. Mais qu’en est-il de l’œuvre de Gary Hill Inasmuch As It Is Always Already Taking Place (1990) dans laquelle les images sont placées sur un support vidéographique dont, avec un peu de soin, on pourra assurer la longévité, alors que le container est constitué par des tubes cathodiques déboîtés ?
Ces tubes sont visibles et essentiels à l’œuvre, celle-ci établissant une sorte de rapport entre le corps humain (que l’on voit dans les écrans de diverses grandeurs) et le corps de l’image (ici les tubes et le filage que les alimente). Ainsi, on peut imaginer dans l’avenir une situation où un artisan de l’ère électronique pourra fabriquer, à la main, de tels tubes. Dans l’intervalle, une stratégie pourrait être de stocker des tubes en vue de remplacer les tubes existants ou de les réparer. Mais une telle solution ne saurait être, à très long terme, une garantie de pérennité. Encore faudrait-il savoir ce que l’artiste en pense.
Dans le cas des œuvres récentes de Jim Campbell comme Church on 5th Street (2001), le contenu est constitué d’images vidéo numérisées à très basse définition stockées dans la mémoire d’un microprocesseur et l’image nous apparaît sur un écran de diodes électroluminescentes. Comment envisager adéquatement la conservation à long terme d’une telle œuvre ? Le contenu, les images, sont des images vidéo incrustées dans la mémoire d’un circuit électronique et elles sont diffusées sur une grille de LED les reproduisant à très basse définition. Le container, le microprocesseur électronique, devra sans doute être dupliqué, quoique ici il faudrait sans doute demander la contribution de l’artiste, qui fabrique ses propres circuits. Devrait-il nous fournir la documentation technique, devrait-il nous fournir ses images sources (des images tournées avec une caméra vidéo de modèle courant) ? Comme on le constate aisément, chaque cas peut poser plusieurs problèmes ; mais dans la plupart des cas c’est l’artiste qui détient une part de la réponse. Tant que l’artiste est vivant et disponible, il fait partie du contexte, mais une fois l’artiste disparu, la documentation devient souvent la source privilégiée pour déterminer la teneur de l’œuvre et son degré de variabilité. Enfin, est-il envisageable que les œuvres aussi soient mortelles ?
1 Il est né en 1927.
2 www.docam.ca et www.variablemedia.net.
3 Paris, Éditions documentaires, industrielles et techniques, 1951, 48 pages.
4 Simon, Tanner, « Managing containers, content and context in digital preservation: towards a 2020 vision », Archiving 2006 Conference Proceedings. Ottawa, Canada, The Society for Imaging Science and Technology, 2006.
Jean Gagnon est commissaire d’exposition et critique d’art. Reconnu comme spécialiste de l’art vidéo dès les années 1980, il observe plus particulièrement les rencontres de l’art avec les technologies. Il est, depuis mars 2008, directeur de SBC galerie d’art contemporain à Montréal. De 1998 à 2008, il a été directeur général de la Fondation Daniel Langlois pour l’art, la science et la technologie. De 1991 à 1998, il a été conservateur des arts médiatiques au Musée des beaux-arts du Canada.