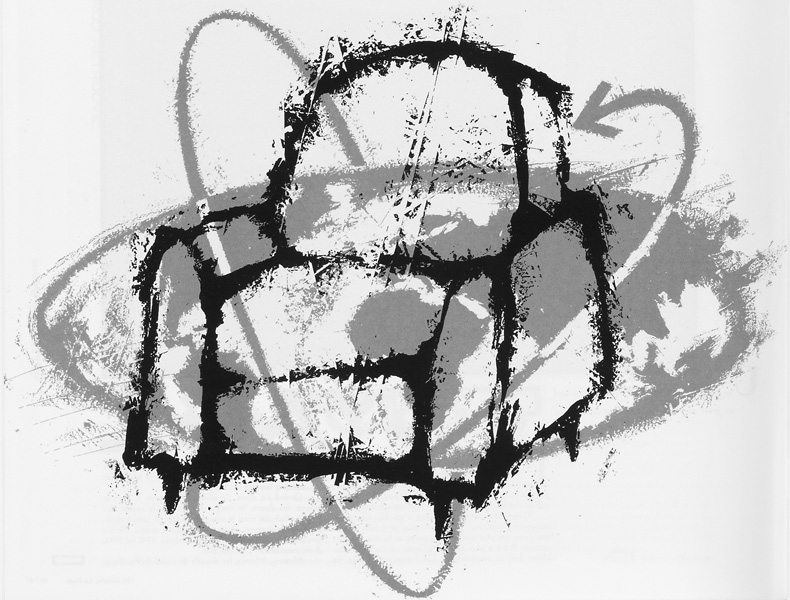[Été 1990]
par Hélène Monette
Un grand vent m’a soulevée du sol et je n’ai plus eu toute ma terre.
La Mer d’Aral. La forêt tropicale dans le bassin de l’Amazone. Saint-Basile. La Baie. J’ai bien aimé. Sac au dos, il y a quelques années. Le climat, les gens, la nourriture. Le mercure dans l’eau, la poussière radioactive dans le vent. J’aimais bien voyager, avant.
Tchernobyl, Gentilly, Bhopal, c’est déjà loin. Mon passeport est périmé. Je n’achète plus de tickets d’autobus. Je ne fixe plus non plus les avions et les jets entre les nuages. Il n’y a plus de ciel. L’ozone est un vieux problème dont on ne parle plus. Les océans ont chaviré. La géographie terrestre n’a plus rien à voir avec les défuntes mappemondes. Les climats sont renversés. Je n’irai plus au bois. Les lauriers ont flambé.
Quand j’y allais, j’y allais. Totalement. C’était le temps des fleurs, le temps des fraises, le temps des sucres. Puis est venu le mauvais temps. Le temps aboli. Est venu le moment où on n’avait plus le temps. On n’a pas pensé à ça. On ne sortait plus dehors. 1992 ou 1993, je ne me souviens plus très bien.
Mexico, Athènes, les massifs de corail du Pacifique.
J’ai dû rêver. J’ai dû avaler trop de bleu, trop de rose, trop de lumière, trop de niaiseries et trop d’amour quand j’étais jeune. Un matin, ça ne tenait plus. Ça n’a plus tenu. Il était arrivé trop de choses. Et les choses ne pouvaient pas aller plus loin. La naïveté était arrivée au bout de son chemin.
J’ai repris la route, dans ma tête. Un grand vent m’a soulevée du sol et je n’ai plus eu toute ma terre. J’accroche sur des détails. Des cartes postales de l’après-guerre. Des régions désertées, désertiques, déshydratées, désaffectées, désapprovisionnées. Des pays liquéfiés. Des contrées asphyxiées.
Soledad. Un seul mot d’espagnol pour tous mes souvenirs brûlants. L’impression d’un grand désert que je n’ai jamais vu, où je n’ai jamais mis les pieds. Sahel, Sahara, Mer d’Aral. J’ai la gorge sèche. J’avance mal.
Crever ou geler. Cuire, frigorifier. Des extrêmes. Des pays barbares. Des gens extraordinaires. Des nomades à la pelle. Des gitans derrière chaque coup de vent. Des villes, des lieux qui n’existent pas. Des vitrines, des bals populaires, des combats de coqs, des gares humides. Des valises, des avions de papier, des lettres d’adieu. Des services ferroviaires interrompus. Des étreintes d’aéroport. Des notes de télégrammes facturées à la poste restante. Des cartes postales, des lettres anonymes, des phrases qui dépassent la pensée. Des appels outre-mer qui défoncent la santé. Des retours-sur-soi-j’arrive-en-ville. Des départs qui tardent toujours. Des retours lourds.
J’ai des souvenirs de voyages comme ça. Le Nord tout le temps. Le Sud surtout. Des parures, des breloques en plastique coloré. Du fil de fer transporté avec les passagers. Des pamplemousses blancs déboulant d’un panier. Des montagnes à spectres. Des enfants à rubans rouges et blancs sur les genoux. Des chiens sauvages aux poignets. Des klaxons, des crieurs, des radios. Bruit par-dessus bruit, je n’ai toujours entendu que la mer.
Maintenant que j’ai perdu mes cheveux et qu’il me reste deux dents, je me trouve trop horrible pour sortir dehors. On ne joue plus non plus, dehors. Je ne vais plus très loin. Jusqu’à la chambre, au sud, jusqu’au divan, au nord.