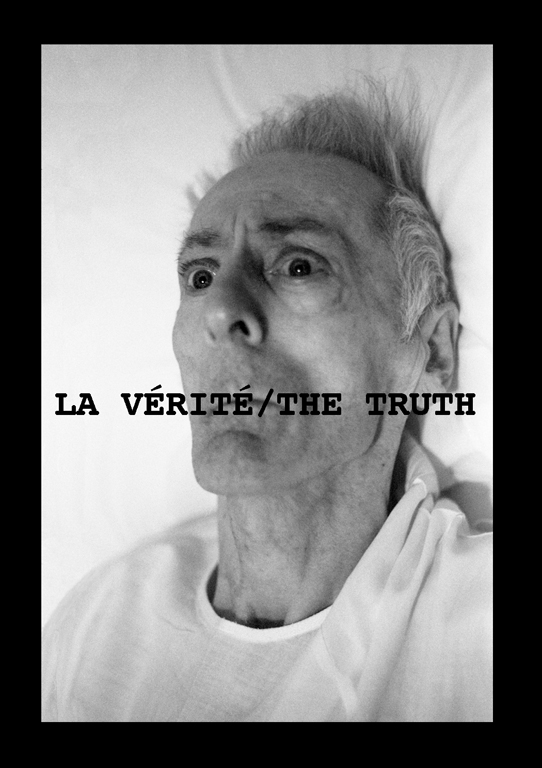[Été 1996]
par Marcel Blouin
Je me présente ici officiellement en tant qu’adversaire du «culte de l’objet» et en tant que défenseur de l’«immatérialité» en art. Soyez sans crainte, contrairement à George Berkeley (1685-1753), je me réclame d’un immatérialisme athée et existentialiste.
Ce n’est pas parce que l’idée est immatérielle qu’elle n’existe pas. D’abord l’humain existe, ensuite il produit de l’immatérialité qui, elle, à son tour, existe tout autant que la matérialité. Je suis donc bien loin d’affirmer que l’essence précède l’existence ; c’est tout le contraire.
Au début du XXe siècle, la mécanisation des activités humaines a créé des remous, comme on le sait, dans des secteurs aussi diversifiés que l’industrie, l’économie, les arts et la vie sociale en général. En art, l’avant-garde s’est beaucoup préoccupée des changements techniques. Les futuristes en firent même leur cheval de bataille. Pour eux, la jeunesse, la fougue, la vitesse, le mouvement, l’urbanisation, étaient d’une importance capitale. la mécanisation et l’industrie étaient perçues comme des bienfaits dont l’homme pouvait et devait profiter. À l’époque le besoin incommensurable de changement et les idées nouvelles ne pouvaient plus être tenus enfermés sous le couvercle de l’académisme hérité de la Renaissance. Hélas, dans le cas des futuristes, cette révolte est allée jusqu’à promouvoir la militarisation et la violence, comme si tout changement était souhaitable et cela même au prix de la guerre et du fascisme.
L’industrialisation a amené les artistes à se pencher sur la notion de «machine». L’usage de la photographie par les modernistes, l’engouement (Ernst, Heartfield, Hausmann, Rodtchenko, etc.) pour le photomontage et l’apparition de la photographie dans le champ de l’art moderne ont coïncidé avec l’industrialisation de l’Occident au début du siècle. L’appareil photo est une mécanique : comment ne pas faire le lien avec la naissance et le développement de l’industrie ? Le processus de transition d’un mode de production à un autre et l’histoire de la photographie sont donc alors intimement liés pour la première fois.
À nouveau, la photographie prend aujourd’hui une place importante dans le processus de transition technologique. Les nouvelles possibilités qu’elle offre (de création, de manipulation et de transmission des images) questionnent l’humain sur la perception qu’il a de lui-même en tant qu’entité individuelle et collective. Devant cette nouvelle rencontre de la photographie et du passage historique d’un mode de production à un autre, des questions doivent être posées et des réponses s’imposent. Face aux nouvelles possibilités technologiques, quelle attitude devons-nous adopter ? Compte tenu que la «matière première» de nos sociétés se présente désormais sous la forme de savoirs et de connaissances, il est important de se demander si c’est l’objet matériel ou l’image qui nous intéresse. Est-ce la matérialité de l’objet ou ce qu’elle représente qui nous importe ?
Par exemple, pense-t-on à conserver les bandes maîtresses de films ou de vidéos d’art ? Oui, bien sûr, mais il s’agit là d’une préoccupation en général secondaire. Quand il visionne un film, le spectateur ne veut pas savoir s’il s’agit de la bande maîtresse ; il désire vivre ou revivre des émotions, il s’intéresse au contenu, aux messages, à la symbolique. Le spectateur sérieux veut aussi savoir si l’œuvre visionnée respecte l’intention de l’auteur, il souhaite s’adonner d’abord et avant tout à l’«immatérialité» de l’œuvre, à son contenu et à sa dimension purement visuelle.
Que l’on pense à la littérature : les œuvres de Stendhal, de Zola ou de Kundera, valent pour leur signification, pour leur impact sur notre compréhension du monde, pas en tant qu’objet imprimé que nous avons entre les mains. En musique : sont-ce les partitions sur papier de Bach qui nous élèvent dans son univers spirituel ou n’est-ce pas plutôt cette «immatérialité» qui parvient à nos oreilles par des voies complexes et diversifiées, faisant appel à l’électronique ?
Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus immatériel. Une seule impression, un seul commentaire émis par une personne influente peut changer l’attitude des financiers sur les parquets de la bourse. La richesse d’un pays se mesure à son utilisation du savoir, c’est-à-dire d’une abstraction. Il s’agit d’une richesse immatérielle, virtuelle, le concept l’emportant sur les qualités formelles de l’œuvre, voire sur sa matérialité ? Il en est de même pour l’art d’un pays ou d’une nation puisque l’activité artistique ne peut être détachée du monde qui se fabrique quotidiennement.
Doit-on privilégier l’aspect matériel du support ou son contenu, dans le cas de la photographie qui est, par définition, multipliable ? Le baiser de l’Hôtel de ville de Robert Doisneau, pour prendre un exemple bien connu, nous touche et a touché des millions de gens sans que la très grande majorité d’entre eux n’ait eu accès à l’original (On ne peut s’empêcher de penser au Musée imaginaire de Malraux). Le message de Doisneau, son message d’amour et de liberté dans ce cas-ci, a rejoint le public que le photographe souhaitait toucher, probablement au delà de ses espérances, et cela sans même faire appel à l’original ? Et cet original, il est fondamental pour qui, pour quoi, pour quel médium ?
L’essentiel de l’œuvre photographique se situe-t-il dans l’objet matériel, le support, le papier photographique ? ou dans l’aspect visuel, dans la perception du monde d’un photographe transmise aux spectateurs ? Bien sûr, pour les spécialistes de la photographie, le fait de conserver l’original est fondamental. Nous connaissons la valeur des vintages, l’importance des tirages réalisés par l’auteur ou sous la supervision de celui-ci, acceptés et accrédités par lui. Mais, de façon à ne pas être dépassés par les événements, de façon à ne pas être associés au monde de la philatélie et de la numismatique — suis-je trop dur ? —, il faut bien garder en tête que l’essentiel de l’œuvre photographique réside dans son immatérialité, dans ce que celle-ci laisse comme trace mnémonique chez le spectateur. Ainsi, de photographie, elle devient «image fixe» qui peut être diffusée sur de multiples supports.
Comme au début du XXe siècle, nous vivons un bond technologique important et, conséquence de ce «progrès informatique», un nombre impressionnant d’individus sont tenus à l’écart de la société active. Il est devenu évident que le passage de la société industrielle à la société des communications crée des changements profonds ? Nous sentons chez les marginalisés d’aujourd’hui, comme chez les modernistes de l’époque de la révolution industrielle, une envie de valoriser le changement par toutes les voies possibles allant de la promotion inconditionnelle des technologies informatiques aux actions violentes en passant par le souhait d’un chaos total dans les institutions. Rien à perdre ! Autre élément fascinant (inquiétant ?) : est-ce une simple coïncidence si l’image photographique est appelée, aujourd’hui, à être découpée, copiée, collée comme elle ne l’a pas été depuis la belle époque du photomontage d’influence dadaïste ? Tout un circuit d’artistes travaillent présentement en marge des réseaux officiels dans des conditions difficiles à l’extrême, dans la plus grande ignorance des mécanismes du marché de l’art, des musées et des subventions. L’art est ailleurs. Dans mille ans, que retiendrons-nous de notre époque : les acquisitions de nos musées d’art contemporain ?
Nous ne sommes peut-être plus à l’époque où les manifestes rassemblaient les artistes autour d’idées communes, mais il est urgent, puisque le rouleau compresseur de la logique du marché broie tout, de dénoncer certaines absurdités. Le vrai débat de l’art actuel n’est pas dans la confrontation des «subventionnés» et des «laissés pour compte», ni dans l’opposition du conceptualisme et du formalisme, ni même dans le conflit stérile opposant les tenants de l’abstrait et les défenseurs du figuratif. Il faut plutôt promouvoir l’introduction de la photographie et des arts visuels dans «le monde des arts immatériels» tels que la musique, la littérature, le cinéma, la vidéo, le théâtre et la danse. Mais ces formes d’art sont-elles immatérielles pourrait-on demander. Au sens où je l’entends, oui, dans la mesure où je n’ai encore jamais rencontré un spectateur sortant d’une représentation théâtrale, par exemple, en affirmant qu’il aurait bien aimé faire l’acquisition de cette œuvre s’il en avait eu les moyens.
Actuellement, on demande à un photographe de réaliser une image-objet qu’il devra vendre 1000$ et qui devra durer mille ans. Cela représente un dollar par année. Voilà ni plus ni moins ce que l’acquéreur potentiel demande. Si un jour ce photographe devient un «incontournable», qui va en profiter ? Le propriétaire de cette image-objet, bien sûr, ou sa succession. Quelle injustice ! Il faut imaginer d’autres formes de diffusion de la photographie, d’autres formes de financement. Imaginons, explorons ! Cessons de nous mettre la tête dans le sable ! Combien d’artistes peuvent prétendre recevoir un revenu décent de leur création dans le contexte actuel ? Des réponses et des esquisses de solutions encore à découvrir semblent se cacher dans la notion d’«immatérialité». Vous l’aurez sans doute compris, mon but n’est pas ici de nier la matérialisation de l’art sous forme d’objet, mais plutôt de déplacer la valorisation du travail de l’artiste — et sa valeur marchande — en dehors de celle-ci.
Nous ne pouvons plus nous contenter du marché de l’art tel qu’il existe, c’est-à-dire un marché valorisant la possession d’un objet unique ou à tirage limité et ayant une durée de vie illimitée dans la mesure du possible. Il faut sortir les arts visuels des réseaux de diffusion traditionnels, faire appel aux nouvelles technologies tout en demeurant critiques face à celles-ci. À ceux qui disent qu’une «bonne photographie» tirée en chambre noire vaut mieux qu’une image travaillée par ordinateur ou présentée sur écran cathodique, je répondrai simplement par une question : qu’est-ce que les peintres pensaient de la photographie il y a cent ans ?
Avons-nous besoin d’une révolution tranquille ? agitée ? explosive ? Les artistes doivent se faire entendre et descendre le «prêtre économiste» de son piédestal. Tout cela, dans le fond, afin de mieux vivre, collectivement, une transition incontournable, et d’éviter une confrontation violente. Prémonition apocalyptique irréaliste et pessimiste ? Il faudrait être bien naïfs et prétentieux pour penser que nous sommes désormais à l’abri d’une barbarie à l’échelle continentale ou mondiale.
L’art est rattaché au monde dans lequel nous vivons. Il reflète ce monde, diront certains ; il le transforme, diront les autres. J’émettrai simplement, pour ma part, l’hypothèse que l’art fait l’un et l’autre à la fois. L’avenir doit résider dans l’ouverture et dans l’attention que nous accorderons aux jeunes et aux artistes. Mais, surtout, l’espoir réside dans les contacts directs avec le public spectateur car, il ne faut plus rêver, nos gouvernements ne pensent guère à faire une place aux artistes, trop préoccupés qu’ils sont à gérer la dette, et incapables de ralentir les écarts grandissants entre nantis et marginalisés.
Marcel Blouin est photographe. Il vit et travaille à Montréal.