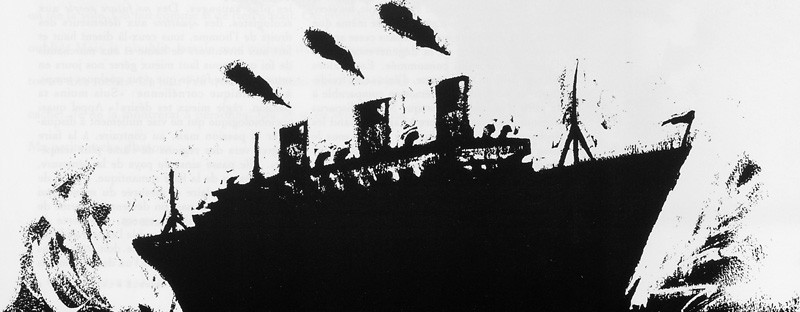[Printemps 1989]
par Michel Peterson
Comment penser la passion dans un monde que les meilleurs interprètes nous disent, depuis déjà un siècle, désenchanté, déshumanisant et déclinant?
Par exemple, les étonnants progrès du génie génétique de même que la diététique nous font sans cesse appréhender; moment où la dégénérescence de l’homme sera enfin consommée. Est-il alors dans un tel contexte, d’énumérer froidement les attributs d’une émotion comparable à griffe d’un vautour, lorsque 30,000 disparus argentins manquent encore à l’appel, quand les esclaves haïtiens sont plus que jamais sous le joug dominicain ou quand, beaucoup plus près de nous (sous nos yeux, pour ainsi dire…), des centaines d’enfants maltraités vivent dans la terreur d’une honte insoupçonnable? Et dans les quelques rares pays où ne sévissent pas la faim et la violence, la mort emprunte les visages les plus inouïs et fait passer la passion pour une erreur qui se paye par une absence de l’homme au monde.
Pourtant certains cherchent toujours la dignité en luttant contre le cannibalisme politique qui s’apprête à bouffer jusqu’à nos intimités les plus sauvages. Des no future people aux écologistes, des squatters aux défenseurs des droits de l’homme, tous ceux-là disent haut et fort aux inventeurs de haine et aux marchands de foi qu’il nous faut mieux gérer nos jours en retournant, ne fût-ce que pour quelques temps, à une éthique cornélienne: «Suis moins ta passion, règle mieux tes désirs ! » Appel quasi sociobiologique qui ne vise nullement à disqualifier la passion mais, au contraire, à la faire migrer vers des régions de l’âme plus tempérées. Elle passe ainsi du pays de la démesure, de l’excès ou de la folie romantique, à celui de la possession claire et mesurée du monde qui nous entoure. La passion devient, au terme de cet interminable déplacement, une sorte de sereine ferveur et si elle semble l’aspect de l’être le moins facile à mesurer, elle doit néanmoins se donner désormais comme l’un des sentiments qui permettent à l’homme de témoigner sur sa vie et sur celle de l’autre. À l’instar du grand sport ou du grand art, elle n’a dès lors plus rien à voir avec le quantifiable, avec le titanesque. Seule compte sa qualité intrinsèque puisqu’elle ne correspond jamais à notre état naturel.
Or de quelle manière vivre cette étrange passion neutre et objective qui rend l’homme semblable à la métaphore parce qu’elle l’oblige, de rages en violences contenues, à se tenir constamment sur ses gardes ? Il faudrait bien du courage pour s’exposer ainsi à la vengeance de la matière. Car, en effet, sitôt l’homme sorti de chez lui, sitôt hors de son humble territoire, l’individualisme contemporain le conduit à fuir l’amour dans la mesure où il risque d’offrir la possibilité que sa passion ne soit pas exclusive. Que faire? Braver la mort, narguer l’existence ou défier constamment la gravité, c’est-à-dire voyager en compagnie de la passion qui nous meut?
Pour ma part, le voyage a pu me faire comprendre que la passion est d’abord le mode de discours par lequel le sujet argumente à propos du monde et se constitue dans l’imaginaire de ce qui se dévoile à lui. Chaque pas sur une terre étrangère, chaque mot prononcé dans une langue qui n’est pas encore la sienne, autorisent l’homme à se découvrir une chair qui excède les dimensions de sa conscience. Par ces échanges rhétoriques, il entrevoit ses volumes, il prend forme et consistance dans le moment de sa parole — qu’elle soit d’amour ou de mort. Qui a voyagé se souvient de ces obscurs instants de révélation pendant lesquels il existe soudain, surpris par sa présence. Pour l’un, cela s’est passé à Katmandu, devant un monument bouddhique. Pour l’autre, au Sénégal, pendant une discussion avec un éleveur ouolof. Un autre encore a été frappé par l’éloignement ressenti dans une chambre délabrée d’Amsterdam ou de Tokyô. Pour ma part, c’est le Brésil qui m’a insidieusement transmis le calme de la passion.
Je ne dirai pas ce qui m’attendait au pays de la constitution du corps. Je ne dirai pas que le Christ Rédempteur de Rio m’a précipité pour longtemps dans un espace sacré que je suis incapable de résoudre. Je ne dirai pas non plus que, vu de l’appartement d’amis, sur le flanc d’une colline de Porto Alegre, le soleil se couchant sur le Guaïba m’a converti à moi-même. Non, cela serait trop trivial. Les Laurentides aussi proposent de tels événements. Peut-être. Mais ce que j’ai aperçu sur cette colline ne ressemble pour moi à rien d’autre. J’ai vu la musculature du soleil. Cette vision m’a enseigné la puissance passionnante du Brésil, sa structure organique. Qu’ai-je donc reconnu si ce n’est, de l’autre côté de la guerre, l’aventure du vivant sur des continents qui continuent encore à nous paraître abstraits. Mon aventure m’a révélé ceci : le voyage est le destin de la passion. J’étais enfin perdu.