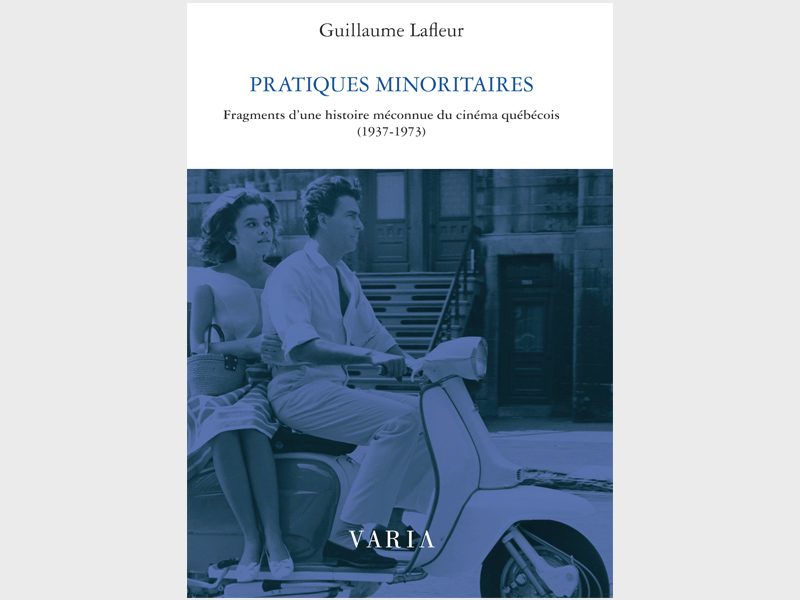Montréal, Éditions Nota Bene, 2015, 166 p., ill.
Par Alexis Desgagnés
[Extrait]
Toute pratique historienne suppose un choix éthique décisif : l’historien se satisfera-t-il de camper son discours dans l’évidence relative et la sécurité illusoire du canon, ou cherchera-t-il plutôt à éclairer humblement les quelques traces intelligibles qu’il aura soutirées au chaos de l’éternité ? C’est sous la tension de cette dialectique qu’il faut lire Guillaume Lafleur. Le livre qu’il consacre à quelques pratiques cinématographiques jusqu’ici boudées par la critique spécialisée s’ouvre d’ailleurs sur l’énoncé d’un souhait : que soit enfin entreprise une relecture de la « grande fiction » qu’est l’histoire du cinéma québécois. En marge des principales institutions, en premier lieu de l’Office national du film du Canada (ONF), plusieurs œuvres, dont l’auteur met habilement l’importance en lumière, ont été produites hors du cadre dominant de l’industrie québécoise entre 1937 et 1973. Nombre de raisons expliquent le silence régnant sur ce pan méconnu de notre cinématographie nationale : ségrégation d’œuvres considérées comme appartenant au cinéma amateur, pauvreté du commentaire qu’elles ont suscité, diffusion restreinte, voire inexistante, inaccessibilité relative des copies et tutti quanti. Redevable à la cinéphilie « militante », « désintéressée et insoumise » de Patrick Straram, dont il dit s’être inspiré, Lafleur propose donc quelques « fragments » d’une histoire parallèle du cinéma d’ici.
Avant de résumer le propos de ces fragments, soulignons le parcours de l’auteur. Critique et historien du cinéma, Lafleur a œuvré comme programmateur ces dernières années, notamment chez le diffuseur Antitube (Québec), puis au sein de l’équipe de la Cinémathèque québécoise (Montréal). Ce fait significatif explique en grande partie la recherche effectuée pour documenter son ouvrage. Il est aisé de se figurer les écueils rencontrés par le programmateur souhaitant, à la satisfaction des cinéphiles, mettre la main sur certains films d’auteurs peu distribués ou dont les rares copies sont perdues, voire oubliées, dans les dédales poussiéreux de collections ou de fonds d’archives. À contre-courant des recherches abordant d’abord l’histoire du cinéma par ses discours et son historiographie, c’est plutôt en affrontant les contraintes matérielles du travail de programmation que l’auteur a retracé et documenté les « pratiques minoritaires » qu’il discute dans son livre. Cette recherche menée sur le terrain aura permis à Lafleur de positionner sa démarche en marge des approches dominantes de l’histoire du cinéma, envers lesquelles il se montre d’ailleurs critique.
C’est avec l’examen du parcours de Fedor Ozep et de René Bonnière que s’ouvre le corps de l’ouvrage. Russe d’origine, dont la contribution à l’histoire mondiale du cinéma a été, ainsi que le démontre l’auteur, largement mésestimée, Ozep a travaillé successivement à Moscou, à Rome, à Berlin et à Paris avant d’atterrir à… Saint-Hyacinthe, où il a réalisé Le père Chopin (1945), « premier long métrage de fiction québécois qui soit parvenu jusqu’à nous ». Devait s’ensuivre La forteresse (1945), film tourné en grande partie dans la ville de Québec et qui précède de quelques années le célèbre I Confess d’Hitchcock, dont l’action est aussi située dans la capitale. L’auteur enchaîne avec l’analyse d’Amanita Pestilens (1963), film méconnu de René Bonnière, dont l’originalité n’avait pourtant pas échappée à Denys Arcand, qui avait publié une critique de cette œuvre dans la revue Parti pris au mitan des années 1960. Selon Lafleur, ce film, qui raconte l’invasion de champignons sur une pelouse verdoyante de banlieue, constitue l’un des commentaires les plus percutants de l’époque sur la vie quotidienne, Bonnière illustrant d’une main de maître la tension entre urbanité et ruralité.
L’auteur poursuit en consacrant un chapitre de son ouvrage aux trois pionniers du cinéma expérimental québécois qu’ont été Gordon Webber, Cioni Carpi et Étienne O’Leary. Élève de László Moholy-Nagy au New Bauhaus de Chicago, Webber, qui enseigna l’architecture à l’Université McGill et fut l’un des signataires du manifeste Prisme d’yeux, est l’auteur d’un court métrage non figuratif réalisé en 1948 et n’ayant été montré sous sa forme définitive qu’en 2012, à la suite de sa restauration par la Cinémathèque québécoise. Quant à Carpi, Lafleur montre l’apport de cet artiste d’origine italienne au cinéma d’animation canadien en abordant des films aux titres évocateurs : Point et contrepoint (1960), L’oiseau maya (1961), Un chat ici et là (1961) et I Will… I Shan’t (1962). Tapi avec Carpi dans l’ombre d’un des nombreux trous de mémoire de l’histoire, O’Leary, selon Lafleur, n’en demeure pas moins, pour sa part, l’inventeur du cinéma underground québécois dans les années 1960, notamment avec son « trip cinématographique » intitulé Day Tripper (1966), dans lequel « rien d’autre ne compte que le pouvoir de fascination des images ».
On savait déjà l’importance considérable, mais longtemps sous-estimée avant les recherches de Sébastien Hudon1, de la contribution d’Omer Parent aux arts visuels sous le règne duplessiste. Si, jusqu’à maintenant, La vie d’Émile Lazo (1937) n’avait fait l’objet d’aucun commentaire, c’est faute d’avoir été longtemps considéré comme un film professionnel. Tournée à Québec et mettant en vedette le caricaturiste Robert LaPalme, qui en signe d’ailleurs le scénario, cette œuvre constitue pourtant une critique mordante de la société québécoise contemporaine, déployant plus d’un artifice créatif pour emberlificoter la censure. Pour ce faire, Parent a pu compter sur les possibilités des nouvelles caméras 8 mm, qui lui ont permis de montrer « la misère culturelle telle qu’on peut l’observer dans toutes les couches de la société ». Quelques années plus tard, c’est plutôt de la portabilité de la célèbre Paillard-Bolex que Gilles Groulx a tiré profit pour tourner son premier film. Dépourvu de bande sonore, Les héritiers (1955) témoigne de l’intérêt obsessif du jeune cinéaste pour le cadrage et les plans fixes, qui lui offrent « la possibilité de peaufiner l’art de l’image pour elle-même, proche de la photographie en mouvement ». Une décennie après Les héritiers, Diane Dupuis, encore adolescente, partage avec Groulx le même goût pour la photogénie, dans un parcours aussi prolifique que fulgurant au cours duquel elle a réalisé cinq films en moins de deux ans (1965-1966). Ainsi, des œuvres telles que Veulent ou Les amazones s’inscrivent dans le sillage de La vie d’Émile Lazo et des Héritiers, en ce qu’elles procèdent d’une sensibilité mettant les ressources de l’esthétique au service de récits originaux qui n’en demeurent pas moins de puissants documents témoignant des mœurs d’alors.
Guy Borremans et Arthur Lamothe, figures plus familières de l’histoire du cinéma québécois, ont-ils mérité de voir amoindrie leur contribution à celle-ci, étant donné les rôles relativement secondaires qu’ils s’y sont vu attribuer ? En plus d’avoir été caméraman pour un nombre impressionnant de films, et non les moindres, Borremans a donné à notre cinématographie l’importante œuvre La femme image (1960). Ce film au contenu sulfureux a de justesse échappé à la censure. Il illustre comme peu d’autres la vie quotidienne dans la métropole, laquelle sert de décor à une réflexion peu commune sur la représentation du corps féminin et du désir masculin, à la veille de « la chute imminente d’un empire décalcifié ». Mais surtout, si l’on observe cette œuvre du point de vue de l’économie culturelle des années 1960, il s’agit – fait encore peu usité – d’un film indépendant entièrement financé par son auteur. Comme Borremans, qui est cependant resté dans le giron de l’ONF en sa qualité de caméraman, Lamothe a produit ses films militants en marge des institutions dominantes de l’industrie cinématographique. Il a plutôt cherché un soutien auprès des ministères, des syndicats, et même de l’entreprise privée. Pourtant, aussi novatrices soient-elles, ses œuvres Au-delà des murs (1968), Le perfectionnement des enseignants (1969) et Le mépris n’aura qu’un temps (1970) ne peuvent apparemment qu’être visionnées à la bibliothèque de l’Université Laval… autre preuve que le caractère fragmentaire de l’histoire du cinéma québécois est, pour le pire et à l’image de tant d’autres facettes de notre culture, un état de fait.
Alexis Desgagnés est rédacteur adjoint au magazine Ciel variable.