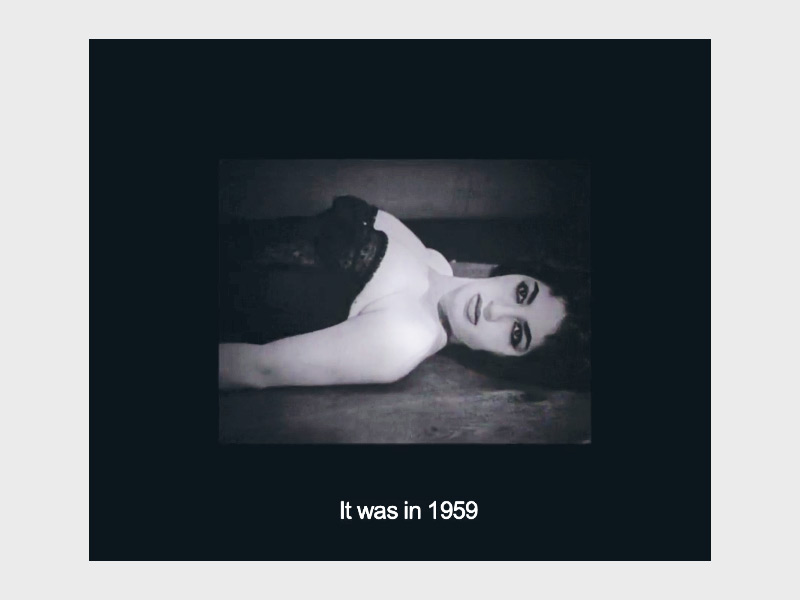[Printemps-été 2018]
Par Claudia Polledri
D’après Akram Zaatari, le terme photographie a plusieurs sens. C’est le message de sa dernière exposition, Against Photography. An Annotated History of the Arab Image Foundation, un itinéraire kaléidoscopique d’histoires et d’images qui nous permet d’entrer dans les archives de l’Arab Image Foundation (AIF ; Fondation arabe pour l’image en français), une institution à laquelle l’artiste est profondément lié. Par cette exposition, Zaatari se propose de retracer l’histoire de la fondation qu’il documente et paraphrase par son regard artistique. Présentée de juillet à septembre 2017 au Musée d’art contemporain de Barcelone (MACBA) et de novembre 2017 à février 2018 au K21 de Düsseldorf, Against Photography fera sa dernière étape au printemps 2018 au National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA) à Séoul, en Corée.
La Fondation arabe pour l’image. 1997–2017 : vingt ans se sont déjà écoulés depuis la création de l’Arab Image Foundation. Établie à Beyrouth, dans un pays encore en reconstruction après un long conflit civil (1975–1990), l’AIF est la réponse heureuse qu’un groupe d’artistes, Akram Zaatari, Fouad Elkoury et Samer Mohdad, apporte à l’absence d’institutions oeuvrant dans la région à la conservation et la diffusion du patrimoine culturel. Dirigée par Marc Mouarkech et Clémence Cottard Hashem, directrice des collections, l’AIF dispose aujourd’hui d’environ 600 000 clichés issus majoritairement du Maghreb et du Moyen-Orient (Liban, Syrie, Palestine, Jordanie, Égypte, Iran, Iraq, Maroc). C’est d’ailleurs par l’illustration de l’ancrage géographique de l’AIF que commence ce parcours, de façon à permettre au visiteur de localiser la provenance des collections, mais aussi à indiquer le rapport entre image et territoire comme étant l’un des fils rouges de cette trajectoire visuelle. Depuis sa fondation, l’AIF n’a pas cessé d’évoluer non seulement grâce aux acquisitions, mais grâce aussi au travail de conservation et de numérisation de son fonds photographique et aux activités menées pour sa valorisation. La quinzaine d’expositions réalisées tout au long de ces années en sont d’ailleurs un clair exemple. Après avoir participé à sa fondation et réalisé plusieurs de ses expositions, Zaatari poursuit sa collaboration avec l’AIF par son travail artistique et il demeure sans doute un des meilleurs connaisseurs du patrimoine photographique de celle-ci.
Il serait toutefois limitatif de voir dans cette exposition la seule illustration de l’histoire de l’AIF. De même, ce n’est pas non plus d’une rétrospective de l’artiste libanais qu’il s’agit, et ce bien que les oeuvres exposées couvrent une période assez large de sa production. C’est plutôt le chevauchement de ces deux parcours, l’un institutionnel et l’autre artistique, qui rend cet itinéraire si riche et stimulant, aussi bien du point de vue des oeuvres que des recherches menées par l’artiste dans les archives de la fondation. Mais ce qui rend cette exposition davantage captivante relève notamment de l’hétérogénéité des traitements auxquels Zaatari soumet l’objet photographique dans le but de mettre en valeur son potentiel documentaire et esthétique, sa technique et la variété des usages et des expérimentations auxquels il peut être soumis. En somme, c’est une véritable réflexion en images que Zaatari propose, un discours sur la photographie qui, comme il l’explique lui-même, « ne figure pas seulement comme médium, mais aussi comme sujet ». Un sujet, ajoutons-nous, qui se veut aussi clairement localisé. En effet, qu’elle soit considérée d’après ses déclinaisons techniques, du calotype au numérique en passant par l’argentique, ou en tant que pratique sociale, on verra comment le rapport de la photographie aux lieux et aux événements qui l’ont traversée tient un rôle central. Il en ressort ainsi une image riche et stratifiée, où l’histoire de la photographie placée au premier plan dialogue constamment avec l’histoire de la région elle-même.
On peut identifier trois axes majeurs qui font l’objet de la réflexion visuelle de l’artiste : les collections, les studios photographiques et la technique photographique, tous étant articulés dans un parcours fort cohérent et nullement didactique.
« Je définis mon travail principalement comme un travail de collection ». Comment décrire dans son étendue un fonds aussi vaste que celui de l’AIF ? Comment présenter ses collections au public et comment les décrire ? Dans la première salle, The Book of All Collections (2017) décrit l’intention de l’artiste de retracer l’histoire des pratiques de collecte de l’AIF et de donner accès au contenu de 300 collections. Pour ce faire, Zaatari s’est appuyé sur les archives de la fondation en consultant les dossiers institutionnels, les biographies, les notes d’acquisition, les rapports de recherche, etc., un travail important sur le plan documentaire que l’artiste poursuit dans les autres salles en mettant en œuvre des approches différentes, axées directement sur les images.
Parmi celles-ci on retrouve, par exemple, la méthodologie adoptée pour plusieurs expositions de l’AIF et qui consiste à créer des séries d’images autour d’un élément qui est apparu comme récurrent, indépendamment de la provenance des clichés ou de leur datation. C’est le cas de deux séries en particulier, la première The Vehicle (2017), en partie reprise de l’exposition The Vehicle. Picturing Moments of Transition in a Modernizing Society (1999), et Men Posing While Crossing Ain el Helweh Bridge (2007), dont les images sont issues de la collection d’Hashem el Madani. Expressions visuelles des changements d’une société lors de l’avènement de la modernité, ces photos vernaculaires se caractérisent par le rôle central accordé à la représentation de la voiture. Placée au premier plan lors des portraits de famille, le père fièrement au volant, la mère et les enfants installés à l’arrière (1920, collection Tania Balkalian), ou scénographie d’événements festifs (Mariage Georges Haimari, années 30, Liban, 1930, collection George Khayat), la voiture représente le véritable sujet de cette série, ainsi qu’un indicateur précieux des costumes de l’époque. De plus, le choix de Zaatari d’exposer le recto et le verso des images a pour effet de mettre en valeur la portée documentaire du cliché en raison des nombreuses informations présentes aussi sur l’endos de l’image (inscriptions éventuelles, dates, langue, lieu, présence de timbres, etc.). Dans la même lignée, la série de portraits pris à Ain el-Hilweh, près de Saïda, au Liban, images de jeunes traversant le pont à pied, en voiture, à vélo constituent, par la représentation qu’elles en donnent, une porte d’accès tout aussi significative à la société de l’époque, ainsi qu’un symbole de la modernité en développement. Réalisée en suivant le même principe méthodologique de l’élément récurrent, la série A Photographer’s Shadow (2017) porte sur un autre élément plus strictement « photographique », c’est-à-dire la présence dans l’image d’un facteur normalement considéré comme accidentel : l’ombre du photographe. Sans se limiter à son aspect en apparence banale, Zaatari insiste sur cette intrusion visuelle dans laquelle il voit un « agent de liaison » qui permet de rendre visible la relation entre l’image et son auteur.
Bien que médié par le dispositif filmique, le rapport aux collections qui caractérise la vidéo à deux canaux On Photography, People and Modern Times (2010, 38 min), est tout aussi intéressant. Dans ce cas, c’est la caméra qui opère en tant qu’« agent de liaison » en instaurant une relation entre, d’une part, la dimension privée des clichés, leur vie intime faite d’albums de famille et de souvenirs en guise de légendes, et, d’autre part, le statut public qu’elles obtiennent une fois acquises par la Fondation. Le lien que Zaatari crée entre ces deux statuts au moyen des images est aussi simple qu’efficace. À l’instar de deux clichés collés sur la même page d’un album, l’image filmique est construite en juxtaposant deux plans sur un fond noir. Dans celui de droite, la caméra filme l’écran d’un ordinateur sur lequel on suit l’entretien mené par l’artiste avec les différents acteurs de l’histoire des images. Qu’il s’agisse du propriétaire du cliché, du photographe ou du collectionneur, nous avons accès par leurs narrations aux couches mémorielles rattachées aux images, mais aussi aux nombreuses anecdotes qui les accompagnent et à beaucoup d’autres informations. À côté de cet écran-parole, on observe les manipulations soigneuses des clichés menées par l’archiviste qui dévoile les images l’une après l’autre au rythme de la narration. En revanche, c’est seulement sur les images révélées par l’archiviste que se concentre la caméra dans le deuxième plan, celui de gauche, afin de nous permettre de mieux les saisir. Ce dispositif a pour effet d’offrir au spectateur la rare possibilité de saisir l’objet photographique d’après la parabole de son existence : de l’instant de sa réalisation jusqu’aux gestes qui veillent à sa conservation et son archivage, en passant par les souvenirs qu’il évoque. « L’image sur la gauche, où est-ce qu’elle a été prise ? Sur la route pour la mer Morte ». « Vous souvenez-vous de cette occasion ? Oui, j’étais très jeune. C’était en Palestine, je ne me souviens pas quand. Je pense que j’avais six ou sept ans. On regardait le dirigeable Graf Zeppelin dans le ciel. » Il s’agit probablement de 1929, l’année pendant laquelle le dirigeable Graf Zeppelin a réalisé le tour du monde. Dans ce cas, la modernité passe par le regard des enfants qui observent les avions dans le ciel, la gare centrale du Caire ou encore les bateaux qui parcourent le canal de Suez. Modernité comme synonyme de transports et d’images, photographiques d’abord et télévisées ensuite, que l’on diffusait dans les lieux publics.
Les studios photographiques. « Les gens se servaient de moi pour prendre des photos. Je marchais la caméra à l’épaule. Quelqu’un disait : Hashem, prends-moi en photo ! », raconte le photographe libanais Hashem el Madani. C’est au Studio Scheherazade situé à Saïda, au Liban, et à celui de Leon Boyadjian, photographe d’origine arménienne plus connu sous le nom de Van Leo, au Caire, que Zaatari a consacré plusieurs années de recherches. L’AIF avait d’ailleurs dédié l’exposition Portraits du Caire réalisée en 1999 aux portraits de Van Leo et à ceux de deux autres photographes, Armand et Alban : c’était un tableau suggestif, bien que partiel, de la société égyptienne des années 1940 et 1950 composé de photos de mariages, de portraits de personnalités politiques de l’époque, comme Gamal Abdel-Nasser (Alban, Le Caire, 1950–1952) ou le roi Fayçal II (Alban, Le Caire, 1955), mais aussi d’actrices égyptiennes ou étrangères comme Dalida, photographiées en costume de scène ou avec les pyramides en arrière-plan. En plus de représenter une composante fort significative de l’histoire de la photographie, ces studios ont fait l’objet de plusieurs œuvres de l’artiste libanais, tant en photographie qu’en vidéo.
« J’ai retrouvé une photo de ma grand-mère signée Van Leo, Le Caire, 1959 ». C’est ainsi que débute la vidéo Her + Him (34 min, 2001–2012), un entretien filmé que Zaatari réalise avec Van Leo lors de leur rencontre au Caire en 1998. La conversation entre les deux nous permet de connaître l’histoire de ce photographe né en Turquie, émigré en Égypte et qui, comme beaucoup d’autres Arméniens, choisit de se vouer à la photographie et d’ouvrir son studio. Nous sommes au Caire à la fin des années 1950, à l’époque où la capitale égyptienne est une métropole multiculturelle et l’épicentre d’une incroyable créativité musicale et artistique. Bien que l’histoire de Van Leo nous plonge dans le passé révolu de toute une région, celle de l’époque nassérienne, et dans une géographie désormais devenue imaginaire, ses images nous frappent par leur modernité, l’usage saisissant de la lumière et les poses cinématographiques de ses sujets, signe de l’influence croisée du cinéma égyptien et hollywoodien. « J’ai aimé la photo depuis que j’étais jeune, je recueillais des magazines, les photos des acteurs d’Hollywood et j’étudiai comment la photographie était prise. » Puis, Van Leo nous dévoile sa science du portrait : l’utilisation de la lumière, l’angle de l’appareil, les expressions du visage au moment décisif, les retouches. On sera peut-être étonnés de découvrir parmi ses clichés de nombreuses photos de nus, images en noir et blanc réalisées sur demande dans la discrétion du studio, où la vulgarité fait place à sensualité du corps féminin exalté par les effets tamisés de la lumière.
Relevant de ce même rapport à la monstration du corps, les clichés du photographe libanais Hashem el Madani exposent cette fois-ci de jeunes Libanais soucieux d’exhiber leur masculinité. À la pratique photographique de ce dernier, Zaatari dédie la vidéo Twenty-Eight Nights and a Poem (2015, 100 min) commandée par le musée Nicéphore Niépce. Un hommage émouvant que l’artiste libanais offre au photographe dont le travail a aussi fait l’objet de deux expositions de l’AIF : Hashem el Madani : Studio Practices (2004) et Hashem el Madani : Promenades (2006). Et voici la caméra s’attardant sur ces clichés pris dans la ville, près de boutiques, dans les souks, ou encore sur la plage, parfois en pose, d’autres par surprise, l’objectif étant toujours une occasion puissante de monstration. C’est d’ailleurs en relation aux photos prises par Hashem el Madani sur la plage que l’on retrouve une des séquences parmi les plus poétiques du film. Des négatifs de l’époque parcourus à la loupe par l’artiste, on passe soudain aux images tournées au ralenti et en négatif-couleur sur les plages beyrouthines. Au-delà de l’effet envoûtant lié à la palette des couleurs, du bleu à l’ocre au pourpre, l’association du mouvement et des images en négatif produit chez le spectateur une suspension temporelle fort déroutante, comme si les négatifs eux-mêmes avaient commencé à « bouger ». Ce sera seulement le retour de la caméra sur les clichés en noir et blanc de l’époque qui réussira à replacer les images et le spectateur dans leurs tiroirs temporels respectifs, en nous ramenant à la narration. Une fois les photos prises, Madani les vendait au studio : « 25 piastres pour la photo simple, 50 avec retouche ». Les clichés de la série Objects of Study/Studio Scheherazade – Reception Space (2006), trois gros plans frontaux (110 × 600 cm), saisissent bien l’atmosphère de ce lieu. Ils nous plongent dans son décor vétuste, les murs roses couverts de clichés en noir et blanc, un bureau et un placard rempli par toutes sortes d’objets, d’appareils et d’outils du métier. Un effet-archive que la scénographie accompagnant ces images vise à renforcer : des meubles aux tiroirs entrouverts d’où émergent d’autres images, reproduction des photos de l’époque, des outils pour les retouches, des appareils photographiques. Et soudain la photographie devient un lieu.
Le « négatif » de l’histoire. Jérusalem, 1948, l’année du conflit israélo-arabe : Antranick Bakerdjian photographie sa maison détruite dans le quartier arménien de la ville et les fortifications du couvent arménien Saint-Jacques qui a servi de refuge pendant la guerre. En exposant ces pellicules, sur lesquelles on repère les signes d’érosion, mais aussi la marque du film utilisé, « DuPont », « Nitrate », « Panchromatic », « Safety Film », Zaatari choisit d’accorder au « corps du film » (The Body of Film, 2017) le rôle de témoin du conflit, ces images ayant été réalisées lorsque le photographe a été privé de sa chambre noire et a dû se déplacer vers une autre. Ne serait-ce pas là une manière de représenter, par l’utilisation de la pellicule, « le négatif » de l’histoire, cette « image manquante » comme dirait le cinéaste cambodgien Rithy Panh, qui s’affiche dans les pages vides des albums de famille ? C’est le sujet sur lequel porte la vidéo On Photography Dispossession and Times of Struggle (2017, 30 min). « J’ai perdu toutes les photographies. Toutes les photos que j’ai sont des réimpressions, ma sœur en Égypte les a faites pour moi. Je le lui ai demandé, car je n’avais pas de photos des enfants. J’ai perdu toutes les photos. Ceux qui les ont retrouvées les ont dispersées dans la rue. » « Oui, j’ai perdu ma maison à Jérusalem. Je ne pouvais rien prendre avec moi ». De Jérusalem à Damas, de Damas à Beyrouth : parfois, ce sont seulement les dates qui restent, les images ayant été perdues, laissées dans les maisons abandonnées de force, disséminées le long d’un parcours dont la destination était méconnue, et le provisoire est parfois devenu définitif.
Dans la dernière partie de l’exposition de Zaatari, on retrouve ainsi un autre des thèmes majeurs abordés par l’artiste, soit l’insistance sur la « corporéité » de l’image comme façon de traiter la question de la matière photographique et des processus d’érosion, où « les accidents » dont la pellicule peut faire l’objet, suite à une mauvaise conservation, deviennent la métaphore des « accidents » de l’histoire qui apparaissent en filigrane. La conception de la photographie qui émerge souligne aussi le potentiel esthétique de la pellicule et sa similarité avec les artéfacts archéologiques. C’est le cas de l’image intitulée Archeology (2017), l’agrandissement d’un négatif issu de la collection de Moshen Yammine représentant le corps d’un athlète qui semble émerger d’une strate de poussière. En plus d’exprimer la dimension haptique de l’image, cet effet, issu de la détérioration du support, vise à conférer à celle-ci une temporalité stratifiée, une façon d’attribuer une forme visuelle à l’histoire de la région et de « matérialiser » sa portée testimoniale. C’est le cas aussi du projet Face to Face (2017) auquel Zaatati travaille cette fois à partir des clichés d’Antranik Anouchian réalisés au début des années 1940. Les images en question, toujours sur pellicule, ont été réalisées en superposant et en agrandissant deux négatifs reproduisant l’un, un soldat français, et l’autre, un membre de la communauté de Tripoli. En plus de mettre en valeur le support filmique, c’est au niveau du référent que Zaatari cherche à produire une image signifiante, en évoquant la présence française sur le sol libanais depuis 1920 et qui ne quittera le pays que deux ou trois ans après l’indépendance obtenue en 1943.
« Vous souvenez-vous de Jérusalem ? Vous souvenez-vous de quand vous êtes partie ? » À ce questionnement qui encore aujourd’hui résume la complexité de l’histoire de toute une région, Zaatari répond non pas en niant le sentiment de perte, mais en revenant par l’image à l’époque où l’histoire était encore « indivisée » (Undividing History, 2017). C’est ce qui évoque la série de huit calotypes illustrant le dôme du Rocher et le mont du Temple de Jérusalem. L’artiste les réalise en fusionnant les images du photographe palestinien Khalil Raad (1854–1957) et celles du réalisateur juif ukrainien Ben-Dov (1882–1968) émigré en Israël en 1907. Deux images différentes, certes, mais dont les points en commun restent encore visibles. À condition d’essayer de les regarder.
Postdoctorante et chargée de cours au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal, Claudia Polledri assure aussi la coordination scientifique du CRIalt (Centre de recherches intermédiales sur les arts, les lettres et les techniques, UdeM). Elle est titulaire d’un doctorat en littérature comparée de l’Université de Montréal portant sur les représentations photographiques de Beyrouth (1982–2011) et sur le rapport entre photographie et histoire.
[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 109 – REVISITER ]
[ Article individuel, en numérique, disponible ici : L’Arab Image Foundation d’après Akram Zaatari :
ou variations sur le thème de la photographie
– Claudia Polledri ]