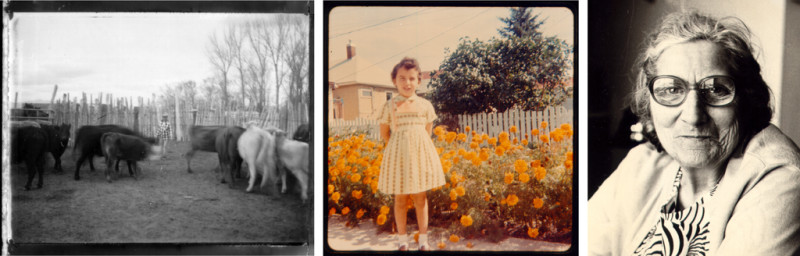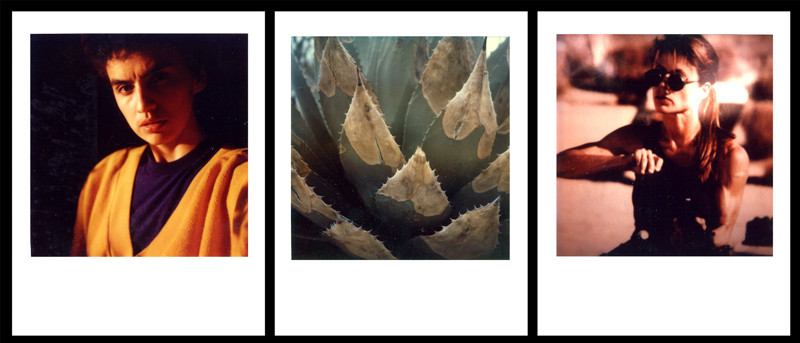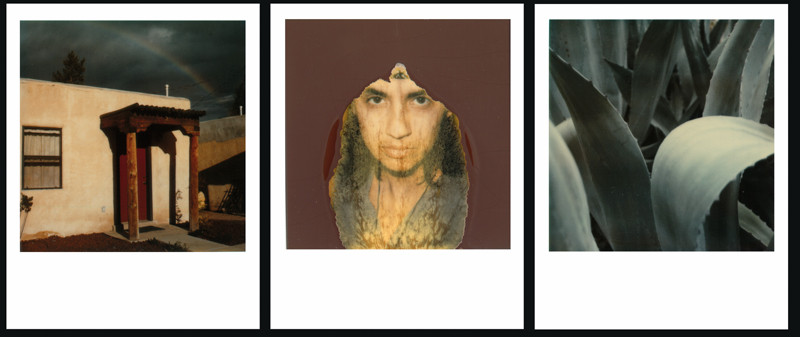[Hiver 2000-2001]
par Ryan Rice et Barry Ace
Feuilleter un album de photos de famille surtout d’une famille autre que la sienne a un côté séduisant qui tient peut-être un peu du voyeurisme.
On a envie de comparer ses expériences, ses liens familiaux et son patrimoine culturel à ceux des autres, de les intérioriser et de les scruter. Il existe toujours un élément romantique, un mince voile blanc, qui s’insinue dans notre interprétation de la réalité transposée sur la pellicule, tandis que nous cherchons à en recréer l’époque et le lieu. Notre vision romancée peut n’avoir aucun lien avec le contexte temporel et spatial de cette image, cédant plutôt au désir nostalgique d’échanger avec les personnages figés dans le temps, de nous mêler à eux.
Living Evidence [Preuve vivante]
Le travail photographique tout comme les expositions antérieures de Rosalie Favell nous emmènent dans un voyage similaire, une randonnée photographique dominée par un désir privé d’appartenance. Dans ses expositions précédentes, dont Living Evidence (1994), Rosalie sondait les sentiments résultant de sa rupture avec sa compagne et de la perte d’amour. Elle s’exprimait par la narration, avec des déclarations écrites à la main sur de grandes épreuves Ektacolor. Elle couvrait d’un ruban adhésif noir les yeux de son amante pour protéger son anonymat, mais gardait les siens ouverts, à la vue du public. Étant donné le caractère très personnel de sa rupture, il était primordial d’y adjoindre un texte permettant d’éviter que le sens d’une œuvre chargée de tant d’émotions ne soit déformé au moment de son exposition publique. Le projet était audacieux et précaire, car il n’est jamais anodin d’afficher son orientation sexuelle. Néanmoins, c’était pour Favell une décision importante, et opportune, puisqu’elle devenait ainsi libre de poursuivre honnêtement son œuvre et d’aborder des domaines inexplorés, à la fois comme artiste et comme métisse. En outre, l’analyse de son identité dans Living Evidence lui a permis de progresser, en intégrant de façon subtile son orientation sexuelle à la quête de son identité en tant que métisse d’ascendance crie.
Les anciens récits indiens
Dans Longing and Not Belonging, Favell s’écarte de l’écriture utilisée pour Living Evidence et revient à une approche plus subtile fondée sur une narration purement visuelle, semblable aux procédés mnémoniques des anciens récits indiens. Ses œuvres rappellent les winter counts (contes d’hiver) ou ledger drawings (dessins sur papier registre) qui ont joué un rôle déterminant dans les récits consignés par les peuples autochtones des Plaines. Les toutes premières relations visuelles étaient transcrites sur des peaux de bison, sous forme de pictogrammes appelés winter counts. Les grandes batailles, les chasses, les événements importants étaient ainsi conservés et faisaient office de chronique. Ces dessins étaient d’importants aide-mémoire, comptant peut-être parmi les plus anciens de tous. Le ledger drawing est une autre forme traditionnelle de narration visuelle. Apparu vers 1875, il était dû à des Amérindiens incarcérés au Fort Marion, à St. Augustine (Floride). Prisonniers de l’armée américaine pour lui avoir résisté et refusé le système imposé des réserves, soixante-treize Cheyennes, Kiowas, Arapahos et Comanches dessinèrent des scènes de leur vie avant leur captivité et la bataille qui avait abouti à leur capture. Ces dessins étaient faits à l’encre et aux crayons de couleur sur du papier registre donné par des fonctionnaires. Après leur libération en 1887, la plupart des captifs retournèrent à Anadarko (Oklahoma), où beaucoup continuèrent d’illustrer des épisodes de leur ancienne vie.
Nous pouvons tous comprendre le désir et la nostalgie de ces prisonniers ; leur rêve d’un retour à des temps meilleurs ne diffère pas de notre désir de revivre nos expériences pour mieux nous comprendre. Tout comme les ledger drawings et les winter counts, les photos de famille de Favell juxtaposées à l’iconographie populaire sont ses points de repère, ses signaux visuels qui lui permettent de revivre un moment précis et de l’explorer. Longing and Not Belonging traite du pouvoir, du pouvoir de la mémoire, eu égard à la récupération d’un pouvoir personnel. Les images de Favell ont un pouvoir thérapeutique individuel et collectif qui nous engage à remettre en question les politiques d’exclusion (liées au sexe, à l’orientation sexuelle, à la culture ou aux institutions), et à rechercher des balises positives pour nous guider.
Le pouvoir féminin
L’œuvre de Rosalie Favell nous entraîne vers des lieux connus de nos propres expériences. Ses photos de famille nous rappellent des moments privilégiés, comme Noël, des anniversaires et ces précieux instants fixés sur la pellicule ; elles nous racontent l’histoire de Favell, métisse crie qui a grandi et qui vit dans un environnement urbain. Favell cherche un point d’ancrage en juxtaposant photos de famille, instantanés Polaroid et images tirées de la culture populaire occidentale. Les images lui sont un miroir où elle peut se regarder et réfléchir à l’endroit où elle se trouve et à sa destination. Son univers est vaste. Comme métisse, elle a des ancêtres euro-canadiens et cris, et se situe quelque part entre les deux. Citadine amérindienne, c’est en milieu urbain qu’elle se sent dans son élément. À partir de ce terrain fécond, elle aborde une multitude de questions complexes. Son œuvre peut paraître quelque peu inaccessible au premier abord ; mais un examen plus approfondi révèle qu’elle reflète beaucoup de nos odyssées personnelles.
La nostalgie de l’appartenance est, en chacun de nous, ancrée dans un moment ou un événement où ce désir d’enracinement fut exaucé. Dans l’œuvre de Favell, le vide est comblé par la combinaison de photos de proches, de fleurs et d’icônes de la culture populaire. La famille représente ses assises, tandis que les fleurs symbolisent l’ancrage, la croissance, le changement et sa quête personnelle d’individualité. Favell émaille son œuvre d’innombrables fleurs ; leur diversité est une métaphore du changement perpétuel et de l’hybridité, une allusion à ses origines métissées. L’élément unificateur provient de l’imagerie populaire de la télévision et du cinéma, réminiscence pour le spectateur de leur passé.
En intégrant à son œuvre une imagerie populaire peuplée de femmes, Favell comble l’écart entre notre désir de nostalgie et notre besoin d’appartenance. Vedettes de la télévision ou du cinéma, ces femmes sont des modèles avec lesquels Favell a grandi, qu’elle a adorés ou qui ont alimenté ses fantasmes. Ils font partie d’elle-même comme de notre sens de l’existence.
Favell trouve dans sa passion pour la télévision une possibilité d’évasion, une occasion de s’intégrer à la culture populaire. Pour la plupart d’entre nous, grandir en tant qu’Amérindien est une expérience unique, rarement abordée dans les journaux, à la télévision ou au cinéma. Les grandes figures amérindiennes sont pratiquement absentes de la télévision, du cinéma et de la radio.
Les femmes présentes dans les juxtapositions de Favell sont, pour leurs consœurs, une source d’inspiration, d’encouragement et une incitation à l’autonomie. Elles sont très intelligentes, compétentes, puissantes. Des qualités dont les Amérindiennes sont fières, pourtant il y a peu de rôles auxquels elles pourraient aspirer. Favell a posé son portrait à côté de celui d’Emma Peel : toutes deux sont calmes, détendues, sereines. Une photo de sa soeur côtoie Xena, la Princesse guerrière, un indice de la force et de la grâce que Favell prête à son aînée. Dans Aliens, Ellen Ripley montre sa force et sa bonté en protégeant un enfant et l’humanité. Plutôt fantastique, mais le pouvoir matriarcal permet d’en faire autant. Dans Terminator 2, Sarah Connor interprète une mère prête à tout pour protéger son enfant. Ces actrices, plus grandes que nature, nous font oublier notre existence banale et précarisée. Elles sont des héroïnes, et non des victimes. Favell a des affinités avec ces femmes, tout comme nous. L’imagerie populaire de Longing and Not Belonging nous rapproche de son existence et de son expérience, parce que nous ne sommes pas si différents d’elle. Nous aussi, nous sommes en quête d’appartenance.
Ryan Rice est le conservateur en chef du Centre d’art indien de Hull, au Québec. Il se consacre également à la gravure, à la peinture et au multimédia. Il est par ailleurs cofondateur et coordonnateur de Nation to Nation, un collectif d’artistes des Premières nations.
Barry Ace est actuellement le directeur des Centres d’art inuit et indien au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Il a signé des textes pour Mary Anne Barkhouse, Michael Belmore, Linda Young, Maria Hupfield, Danny Cutfeet, Rosalie Favell, Marianne Nicholson, Jeffrey Thomas et Rick Rivet.
Rosalie Favell est native de Winnipeg, au Manitoba. Elle a obtenu un baccalauréat du Ryerson Polytechnical Institute et une maîtrise de l’Université du Nouveau-Mexique. Depuis 1984, son travail, en photographie et en mixtes médias, a été présenté au Canada, aux États- Unis et à l’étranger. Elle vit et travaille à Elliot Lake, en Ontario, où elle enseigne à la White Mountain Academy of the Arts.