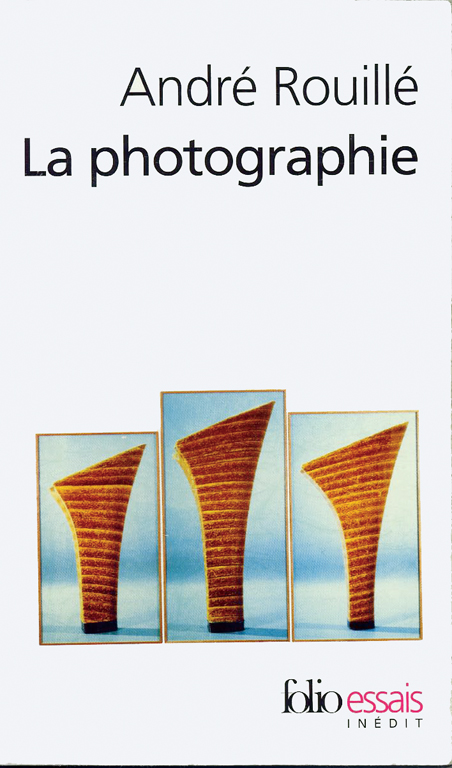[Automne 2005]
André Rouillé : La photographie
Paris, Gallimard
2005
Plus de quinze ans après la parution remarquée d’une anthologie consacrée à la photographie française au xixe siècle (La photographie en France, textes et controverses : une anthologie, 1816-1871, Paris, Macula, 1989), André Rouillé, maître de conférences à l’Université de Paris-VIII, publie un volumineux essai, en vérité une longue leçon, au titre aussi laconique qu’absolu : La photographie. On se surprendra du choix de cet intitulé que l’on prêterait plus volontiers à une publication généraliste d’après-guerre tant celui-ci paraît ignorer la complexité et l’étendue des ramifications du fait photographique. Car l’ouvrage, loin de présenter la photographie sous les espèces d’une curiosité encore méconnue, est porté par l’ambition d’embrasser « toute » la photographie, cela afin d’en revisiter les fondements historiques, d’en observer les développements théoriques, pratiques et artistiques, d’en commenter les discours critiques, mais surtout d’en corriger les interprétations, d’en réformer les lectures, d’en pallier les incompréhensions, voire d’en inverser la culture. « Telle est l’ambition de cet essai, annonce Rouillé : contribuer, en quelque sorte, à remettre “la photographie à l’endroit”. Non pas en délivrant une quelconque vérité, mais en fixant pour programme d’interroger les principales notions qui composent la doxa, ces fausses évidences qui, sans cesse répétées depuis les tout débuts, n’ont considéré la photographie qu’à l’envers » (p. 13). Dès lors, on comprendra que ce titre, moins candide que lapidaire finalement, recouvre en réalité un projet totalisant, redresseur, parfois même revanchard, une sorte de sauvetage de la photographie selon Rouillé, « afin que la culture photographique ne prospère pas sur un immense vide de pensée ». Nous lui en sommes tous très reconnaissants.
Sur plus de 600 pages, Rouillé pose les jalons d’une autre histoire de la photographie, non pas fondée sur de nouvelles figures et pratiques, mais articulée autour d’épisodes assimilés par l’auteur à des moments de rupture, de crise ou de révolution qu’il dramatise aux fins de ses analyses. L’auteur cultive les contrastes, alimente les antagonismes, radicalise les débats, autant pour le spectacle de la démonstration que pour mieux y asseoir le contre-pouvoir de ses positions. C’est ainsi que le déclin inéluctable des potentialités documentaires de la photographie, au profit du développement des pratiques artistiques et culturelles, lui fournit le motif d’une opposition qu’il ne cessera de marteler entre « photographie-document » et « photographie-expression ». Enracinée dans la société industrielle, associée aux pratiques utilitaires et informatives, la photographie-document, qui procède de la reproduction mimétique et de l’enregistrement, constituerait, selon Rouillé, le corollaire négatif de la photographie-expression, caractérisée par son affranchissement de la sphère de l’utile, par l’affirmation de l’individualité de l’auteur, par la reconnaissance de l’écriture photographique. Alors que la première lui apparaît essentiellement rattachée au monde des choses, la seconde traduirait une attention portée aux composantes formelles de l’image. « L’équivalence sans faille entre les images et les choses reposait sur un triple refus : celui de la subjectivité du photographe, celui des relations sociales ou subjectives avec les modèles et les choses, et celui de l’écriture photographique. C’est l’inversion de ces éléments qui caractérise précisément la photographie-expression. » (p. 207).
Dans la première partie de son livre, Rouillé s’emploie à dresser l’historique de cette inversion qui, si elle est intrinsèque à l’histoire de la photographie, se radicalise selon lui dans les années 1980, alors que la photographie-document entre dans une crise profonde et durable. L’ébranlement des valeurs de la société industrielle, l’altération de la croyance en la vérité de la photographie, l’érosion des fonctions illustratives de l’image, la dévaluation des référents au profit des images, la dépréciation des choses au bénéfice des événements, telles sont, entre autres, les causes invoquées par l’auteur pour expliquer le déclin de la photographie-document et l’émancipation de la photographie-expression. Cette dernière surviendrait à l’issue de plusieurs épisodes d’autonomisation de la photographie vis-à-vis de ses diverses applications pratiques et commerciales. Rouillé en identifie le ferment dans l’opposition inaugurale entre Daguerre, dont la qualité descriptive des images oriente d’emblée la photographie vers le domaine des applications pratiques, et Bayard, soutenu par l’Académie des beaux-arts, dont le procédé sur papier, flou mais enchanteur, anticipe l’esthétique des calotypistes, rivaux des partisans du net et du négatif sur verre. Le célèbre débat opposant Paul Périer et Eugène Durieu, dont les termes anticipent le futur clivage entre pictorialisme d’une part et modernisme photographique d’autre part, est rappelé pour illustrer les diverses formes de remise en cause de la photographie-document. L’art machinique et purement photographique de la Nouvelle Objectivité, les expérimentations optiques de la Nouvelle Vision, en réaction aux débordements subjectifs du pictorialisme, sont présentés tels la radicalisation de ce débat historique, que la Subjecktive Fotografie d’Otto Steinert et, dans une certaine mesure, la « photographie créative » promue par Jean-Claude Lemagny prolongeront jusqu’au seuil des années 1980. Le rappel historique de ces oppositions permet à Rouillé de nuancer l’antinomie entre photographie-document et photographie-expression, en soulignant que des forces antagonistes animent cette dernière, tout en rappelant que même « le document réputé le plus pur est en fait inséparable d’une expression » (p. 18), comme l’avait déjà affirmé Walker Evans en parlant de « style documentaire ».
Pour autant, ces tiraillements entre document et expression photographiques sont dans l’esprit de Rouillé subordonnés à une opposition encore plus fondamentale entre d’une part « l’art des photographes » tel qu’il s’est constitué depuis disons Bayard et, d’autre part, « la photographie des artistes » qui « n’appartient pas au domaine de la photographie, mais à celui de l’art. » (p. 382) Dans la deuxième partie de son essai, Rouillé met ainsi en parallèle deux développements historiques distincts : un premier, interne au champ photographique, où document et expression photographiques sont mis en concurrence, et de laquelle confrontation s’affirme l’art photographique; un second, interne au champ de l’art, où la photographie est appelée à remplir des fonctions essentiellement utilitaires, véhiculaires, analytiques, critiques et pragmatiques. Rouillé nous explique alors que la photographie, avant de devenir matériau de l’art contemporain, a joué le rôle de refoulé de l’art avec l’impressionnisme. Il rappelle notamment que la peinture en plein air, qui substitue à la pratique cloisonnée de l’atelier la coprésence du motif et de la toile, l’une des caractéristiques de l’art impressionniste, « consiste à soumettre la peinture à la loi nouvelle que la photographie est en train d’instaurer : la contiguïté entre la chose et son image » (p. 386). Il souligne, comme bien d’autres, que Duchamp, avec les ready-made, lesquels procèdent du choix et de l’extraction, « introduit dans l’art ce principe fondamental de sélection-enregistrement propre à la photographie » (p. 395). Ou encore que la photographie, en tant qu’outil de l’art cette fois, s’inscrit dans une longue tradition, que Bacon et Warhol ont renouvelée, bien que différemment. Avec l’art conceptuel, le land art et l’art corporel, la photographie, nous dit Rouillé, s’inscrit plus résolument dans le champ de l’art contemporain puisqu’elle assume, au même titre que les cartes, textes, schémas et reliquats, la fonction de « vecteur de l’art » (p. 415). Cela, précise-t-il, pour combler un déficit d’objets à une époque où culmine le processus de dématérialisation de l’art. Enfin, la photographie devient, à partir des années 1980, non plus instrument, document, véhicule ou vecteur mais bien matériau de l’art, renouant ainsi, mais en l’amplifiant, avec « une situation d’un demi-siècle antérieure : celle des avant-gardes des années 1920 dont les photogrammes et les photomontages conféraient à la photographie le rôle de matériau artistique » (p. 436).
Après avoir ainsi identifié les articulations maîtresses de cette double histoire – celle de la constitution de l’art photographique d’une part, celle de l’accession de la photographie au champ de l’art d’autre part – Rouillé annonce, dans la troisième et dernière partie de son livre, l’avènement de l’« art-photographie », fruit dialectique de ces deux récits de l’affranchissement demeurés autonomes jusqu’aux années 1980. C’est alors que point « un autre art dans l’art » qui « met fin à l’ostracisme qui a longtemps rejeté la photographie hors du champ de l’art » (p. 451). L’entrée de la photographie dans le champ de l’art serait tributaire de la dévaluation des fonctions pratiques historiquement associées au procédé, condition préalable à la valorisation esthétique du matériau photographique, mais également d’un nouveau phénomène de réification de l’art, alimenté par le marché, où la photographie vaudrait comme « quasi-objet ». Outre la remise en cause de l’originalité moderniste, le retour de la figuration et la montée en puissance de la fiction, autant de motifs issus de la critique postmoderniste, Rouillé invoque la fin des grands récits, plus particulièrement l’essor des micro-narrations, comme singularité de l’art-photographie. À l’extraordinaire du photoreportage de guerre porteur de mythologies nationales succède l’infraordinaire des photographies repliées sur les microcosmes de l’intime et du quotidien. L’accession de la photographie au domaine de l’art contemporain est toutefois décrite comme un phénomène extérieur au champ photographique à proprement parler. « En aucune manière, insiste l’auteur, l’alliage entre l’art et la photographie ne consiste en une interpénétration des champs artistique et photographique. L’alliage art-photographie est le fruit des transformations qui ont affecté le champ de l’art, hors du champ photographique et sans lui, ou presque. Il s’inscrit dans un processus artistique, nullement photographique » (p. 472). Cette affirmation pour le moins péremptoire, qui mériterait bien des nuances, néglige de penser les multiples dimensions de l’art-photographie en dehors de la question de l’art. Car s’il paraît juste de dire que « l’art des photographes » et « la photographie de artistes », pour reprendre les termes de Rouillé, renvoient à des pratiques et à des espaces culturels et professionnels encore très certainement distincts, il est en revanche erroné de croire que l’art contemporain demeure imperméable aux influences exercées par le champ photographique lui-même. Les évolutions internes au domaine du photoreportage ou encore les modulations de la tradition documentaire n’ont-elles pas résolument bouleversé l’art-photographie ? Rouillé semble croire en l’exclusivité régulatrice du champ de l’art, comme s’il s’agissait de l’Académie.
L’argumentation de Rouillé repose sur l’étonnant paradoxe que voici : écrire l’histoire d’un affranchissement – celui de la photographie-expression mutée en art-photographie – tout en proclamant la fin des grands récits. Car, sous la plume de Rouillé, cet affranchissement, qui correspond à l’inscription définitive de la photographie dans le champ de l’art, ce qu’il appelle « l’alliage art-photographie », a quelque chose d’épique : « Quand, à partir des années 1980, s’accroît la crise de la représentation, quand la peinture et la sculpture cachent mal l’écart qui les sépare du monde, quand les matériaux artistiques traditionnels sont comme frappés d’épuisement esthétique, quand les artistes tendent à revenir de l’ailleurs spatial et temporel des œuvres in situ ou des performances vers les lieux consacrés de l’art, quand, à la suite des arts conceptuel et corporel, les arts-événements d’aujourd’hui ne cessent de frustrer les musées et les institutions artistiques de leurs valeurs traditionnelles, l’objet, le faire, la visualité, la monumentalité, alors l’inconcevable arrive : la photographie, l’autre longtemps honni de l’art, peut, comme par magie, devenir l’un des principaux matériaux de l’art contemporain » (p. 469). Afin de remettre la photographie dans le bon sens, Rouillé s’impose la nécessité d’une relecture de l’histoire de la photographie assortie d’une téléologie de la libération. Si l’entreprise a le mérite d’insister sur les lignes de fracture les plus déterminantes de son évolution, elle n’en demeure pas moins incertaine quant à sa pertinence méthodologique. Car peut-on légitimement soutenir le principe d’une histoire totale de la photographie, même révisionniste, alors que les recherches actuelles les plus stimulantes dans le domaine procèdent de l’atomisation et du maillage disciplinaire, du fractionnement et du recoupement des compétences, de l’approfondissement et de l’éclatement des connaissances ?
C’est que la connaissance historique de la photographie repose désormais sur la constitution de nouveaux savoirs, la réhabilitation de l’érudition, la réflexion méthodologique, la problématisation des phénomènes, l’examen minutieux des objets, conditions nécessaires aux croisements fructueux des disciplines, et non plus sur les lectures diachroniques de son histoire, fussent-elles réformatrices. Certes, le livre de Rouillé n’est pas une histoire de la photographie stricto sensu. Il n’en a ni les insuffisances ni les mérites. Pour autant, l’auteur, qui fait siennes les formes discursives canoniques de l’écriture historique, revisite l’histoire de la photographie, mais en surface, sans qu’il lui semble toujours opportun d’ancrer son propos redresseur dans l’observation renouvelée des pratiques, des textes et des discours. Les critiques adressées aux thèses d’André Bazin ou de Roland Barthes, les appels répétés aux textes de Gilles Deleuze, le peu de références faites aux apports des historiens de la relève, la méconnaissance de l’actualité théorique anglo-saxonne, voire le silence sur les contributions de plusieurs chercheurs confirmés révèlent trop souvent les inadéquations d’une position intellectuelle peu sensible aux plus récents développements dans le domaine des études photographiques. Il aurait fallu que l’auteur de cet essai, avant même de projeter de remettre la photographie « à l’endroit », prenne acte de ces évolutions, et rectifie ses propres positions.
Vincent Lavoie est professeur au Département d’histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal.