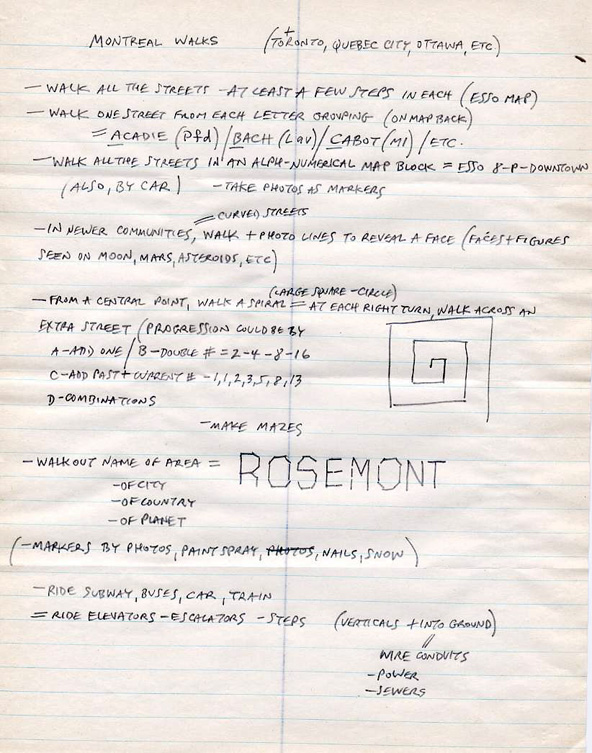[Été 2007]
Bill Vazan, Itinéraires urbains 1960-1970 – Henry Lehman, Tangible and Intangible lines
par Serge Bérard
En août 1969, William « Bill » Vazan construit un croissant de pierres sur une plage de l’île du Prince-Édouard pendant qu’un co-conspirateur, Ian Wallace, fait de même sur une plage de la Colombie-Britannique1. Le titre de l’œuvre, Canada in Parentheses, explique la signification sinon de leur geste, du moins celle des croissants. Ils avaient fait « (Canada) », mais pas avec le mot, avec le pays tout entier. Une idée toute simple, un plan d’attaque qui se résumait à un mot : « (Canada) ». Une œuvre d’exécution modeste, mais si immense « en réalité » que jamais le regard ne pourrait l’embrasser. Voilà ! C’est ça, l’art conceptuel des années soixante ! Il y a dans cette proposition toute la simplicité élégante des meilleures œuvres de la période. Le regard de l’esprit peut y plonger pour toute l’éternité, il y trouvera toujours matière à réfléchir sur ce qui fait une œuvre d’art. C’est comme ces courtes histoires zen, énigmatiques, qui n’ont d’utilité que de vous permettre d’observer votre esprit alors qu’il tente d’en saisir la signification. Par exemple, on ne peut pas voir Canada in Parentheses, mais pourtant on voit très bien…
Il y a aussi Worldline, 1969-19712. Dans vingt-cinq lieux, dispersés sur dix-huit pays, sont placées des lignes indiquant de façon précise la position de chacun de ces endroits par rapport à d’autres points choisis sur la planète selon des coordonnées longitudinales et latitudinales. Cette œuvre permet d’interroger le rôle du spectateur, le lieu d’exposition, la matérialité même de ce qui nous est présenté. C’est encore une œuvre que l’on ne pourra voir que sous forme de documentation photographique ou bien en l’envisageant par l’esprit. Une œuvre si légère, mais pourtant colossale puisqu’elle se sert de la planète elle-même comme socle.
Ici, celui qui pratique une histoire sociale de l’art sent le désir d’ajouter quelque chose. Un petit détail. Worldline parle certes bien de la signification de l’œuvre d’art en en explorant « les frontières » définitionnelles selon ce discours interne auquel nous a habitués l’héritage moderniste, mais l’œuvre témoigne aussi de la réalité extérieure. Le monde s’internationalise dans les années soixante. Le transport aérien s’ouvre aux classes moyennes qui pourront ainsi faire, à l’instar de leurs illustres prédécesseurs, leur « grand tour ». C’est cette même démocratisation du transport aérien qui donna naissance au monde de l’art contemporain international tel que nous le connaissons aujourd’hui. Les pionniers de cette scène internationale en train de naître se sont en toute probabilité entassés, avec le reste de la horde, dans le petit Boeing 707, celui qui donna naissance au « jet age ». Après, pour nous, se sera son frère obèse, le 747, le « jumbo jet »3, incarnation physique de la foudroyante expansion du tourisme de masse, avec son obsession de l’altérité… au moins durant la période des vacances. Le business de l’art contemporain tel qu’il est aujourd’hui avec ses musées qui poussent comme des champignons, avec sa collection sans cesse renouvelée de jeunes « art idols », avec son public « moyen » qui doit bien faire quelque chose en ce beau samedi après-midi dans une ville étrangère car il est encore trop tôt pour aller manger – tout cela n’existerait pas sans l’avion à réaction.
Worldline dit plusieurs choses sur le monde extérieur. Que le monde sera désormais envisagé à l’échelle internationale, mais qu’il ne pourra être perçu que de manière abstraite. Que le monde de l’art contemporain deviendra un gros business mondialisé aux ramifications tentaculaires. Que l’artiste de land art – et la persistance de la graphie anglaise, en français, est très symptomatique, but don’t get me started – voudra, bien sûr, sortir l’œuvre du cube blanc où elle était jusqu’alors captive. Mais l’œuvre dit aussi que le « land artist » se fera le chantre de ce nouveau pouvoir qu’ont les masses d’aller fureter un peu partout. Et partout nous irons ! À traînasser notre solitude ailleurs pour un court moment. En avant, pèlerin !
Le land art est une pratique artistique très particulière. À l’heure du triomphe du public de masse et de l’infrastructure muséale internationale, ces œuvres vont parfois se dissimuler paradoxalement dans des endroits difficiles d’accès, nécessitant peut-être, pour les voir, un rituel compliqué. Elles se mettent alors à dégager une drôle d’aura. Aller les visiter, c’est comme faire, jadis, le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. On dit de certaines œuvres de land art qu’elles peuvent même vous « changer ». Si elles ne le font pas, consolez-vous, au moins aurez-vous vu des paysages extraordinaires. Comme le pèlerin de jadis apercevant la mer pour la première et dernière fois de sa vie. Bien sûr, pour vous, contemporains de Michel Houellebeck, c’est un peu différent, car l’expérience de la mer peut se répéter jusqu’à l’écœurement.
Mais vous rapporterez quand même votre coquille ramassée sur la plage, ou un document photographique, une preuve…
Le laconisme exagéré de l’intention, son économie de signification, typiques de la période de l’art conceptuel, ne dureront pas dans le land art. Il y aura comme une sorte de surenchère de sens. Vazan, comme d’autres avec lui, revoit maintenant sa pratique sous l’angle de la recherche d’une sorte de réconciliation cosmogonique4 – ce ne sont pas ses mots – en cherchant dans l’art, sinon une réponse au moins un réconfort face à la grande question : Pourquoi tout cela ? Ce n’est pas une question banale, et si vous ne vous l’êtes jamais posée, eh bien c’est que la société du spectacle a merveilleusement réussi avec vous ! Pour vos prochaines vacances, je vous conseille Puerta de la Insignificanza. Il y fait chaud, les gars et les filles sont splendides ! Il y a aussi la Biennale des Rencontres Inespérées. Ça promet d’être excitant cette année !
La modernité a apporté une réponse très amère à la grande question : tout ça pour rien ! Samuel Beckett disait que la seule chose qu’il regrettait dans sa vie c’était d’être né, car tout avait alors commencé. Vazan fait partie de ceux qui cherchent, non pas une « réponse » car il n’y en a pas sauf si vous êtes croyant, mais une sorte d’apaisement en proposant un « tout va bien ». Pourquoi le réconfort, l’apaisement ? Parce qu’il y a un pendant moral à la question du pourquoi tout ça : pourquoi tant de souffrance ? L’artiste cosmogonique veut assécher nos larmes en nous rappelant que la grande question porte aussi sa charge d’émerveillement. Tout est affaire de perspective et, on l’a vu, Vazan est un maître, dès le début, des effets de perspective.
Il n’y a rien à redire à la démarche intellectuelle de Vazan, qui est parfaitement légitime. Son recours aux mathématiques suit une tradition millénaire en art et c’est l’une des plus belles associations de champs de compétences que je connaisse. La perspective du « tout va bien », cependant, est un choix. Voltaire, lui, s’insurgeait contre Dieu et contre les prêtres et les philosophes qui proposaient un « tout va bien » dans son célèbre Poème sur le désastre de Lisbonne,5 un des textes les plus émouvants jamais écrits sur la grande question. Il y a un choix à faire : ou bien on se console en contemplant « the big picture », ou on demeure inconsolable. Si, cependant, on se décide pour la seconde option en rejetant les mollasseries de la pensée relativiste et multiculturelle, on se rend compte avec effarement que, comme bonus supplémentaire, comme pour nous réchauffer le cœur, les Lumières sont peut-être en train de s’éteindre.
2 Les documents photographiques de ces marquages faits à l’aide de ruban gommé sont réunis dans un livre : Bill Vazan, Worldline 1969-1971 = Ligne mondiale = Eine Linie die um die Welt geht = Una linea che circola il mundo = Une linea que circula el mundo. s.l : Bill Vazan, 1971.
3 Le premier vol commercial du 747, pour Pan Am, a eu lieu, coïn-cidence, en cette même année 1969. Consultez : http://www.boeing.com/commercial/747family/background.html. Pour le 707 : http://en.wikipedia.org/wiki/boeing_707.
4 Pour vérifier vous-même : http://cybermuse.beaux-arts.ca/cybermuse/docs/VazanClip3_e.pdf. Voir aussi Michel Martin, Bill Vazan : Ombres cosmologiques, Québec, Québec, Musée du Québec, 2002.
5 On peut trouver le poème à http://un2sg4.unige.ch/athena/vol-taire/volt_lis.html.
Serge Bérard écrit sur l’art depuis 1978. Il a reçu son doctorat de l’université de la Colombie-Britannique en 1999 avec une étude comparative du travail de l’artiste français Daniel Buren et de celui de l’artiste américain Robert Smithson.