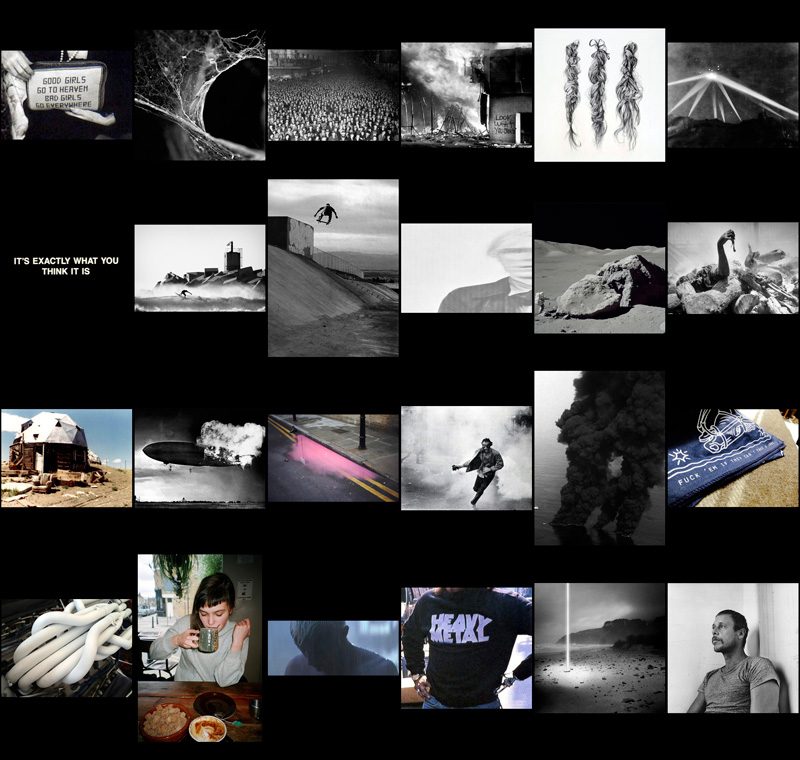[Automne 2013]
par Suzanne Paquet
Tentant jadis de définir la nature de la photographie, Roland Barthes vit en elle « une catégorie nouvelle de l’espace-temps : locale immédiate et temporelle antérieure ». Dans la photographie, disait-il, « il se produit une conjonction illogique entre l’ici et l’autrefois »1. Quelque trente années plus tard, Francis Jauréguiberry faisait remarquer qu’il y a toujours beaucoup d’ailleurs dans notre ici, et ce, à propos… du téléphone portable2. Ces deux réflexions nous indiquent que des spatiotemporalités inédites émergent à certains moments, par la mise au point de certains dispositifs techniques. Évidemment, à l’heure actuelle, on ne peut qu’être captivé par les « catégories de l’espace-temps » qu’installent la culture numérique et les réseaux médiatiques. Je souhaite ici, et c’est là le dessein qui a motivé le choix thématique de ce numéro cyber / espace / public, mettre à l’épreuve quelques conjonctions, croisements ou cooccurrences, peut-être pas illogiques mais certes dignes d’attention : des correspondances – des réciprocités – entre des ici et des ailleurs géographiques et historiques, entre l’espace public urbain et le cyberespace, entre les sphères privée et publique, entre les pratiques artistiques de l’image et les pratiques d’amateurs.
La photographie me guidera dans cet exercice, car en plus d’avoir dégagé des potentialités temporelles ignorées avant son avènement, elle est ce médium technique qui a grandement contribué et contribue encore à la possibilité, ou à la chimère, d’une connaissance exacte du monde par son image. Cela, en corrélation avec divers modes de transport et modalités de communication, les premiers issus, comme elle, de la révolution industrielle. La photographie n’est pas le premier type de représentation mobile, la gravure voyageait déjà bien avant elle, mais elle a une étonnante capacité à emporter la croyance tout en s’immiscant partout.
Formant désormais une sorte de recueil mondialisé, une collection d’images innombrables toujours grandissante, les photographies se font largement publiques, selon une logique inverse de celle qui avait conduit à l’invention de l’album photographique, alors que la fonction de ce dernier était d’abord celle du visionnement en famille, d’un partage dans l’intimité. Dans le Web on le sait, les domaines public et privé s’interpénètrent et se confondent de plus en plus. De même, les dynamiques de l’art d’élite et celles de la culture de masse tendent à évoluer de façon analogue, se faisant écho les unes aux autres, en une relation étonnamment réflexive : l’image fixe et l’activité photographique sont partout, l’art s’en est emparé en imitant leurs usages populaires et, par la photographie, l’art est à son tour repris par les amateurs, et ainsi de suite. De même, l’espace urbain et le cyberespace se considèrent de plus en plus en résonance l’un à l’autre, les actions entreprises d’une part se trouvant prolongées ou rendues publiques d’autre part, souvent par le biais d’images photographiques.
Certains, et ils sont nombreux, ont cru qu’avec l’arrivée de l’image numérique une coupure franche allait s’effectuer, qui signerait la mort de la photographie. Il semble plutôt que c’est comme si les images, la photographie en particulier, n’avaient attendu que le code numérique pour répondre à un désir toujours croissant, déjà présent chez les chroniqueurs du XIXe siècle, celui de « la conquête de la totalité du monde par sa reproduction automatique »3. Si l’entièreté du monde est maintenant rendue visible par son double circulant dans Internet, outre cette prolifération de jumeaux en ligne (l’expression est du spécialiste de l’architecture et des médias William J. Mitchell), d’autres symétries s’imposent, se déclinant, par l’action artistique, de diverses manières que je me propose d’examiner.
Nombre d’artistes aujourd’hui interviennent dans les places publiques des villes, avec des œuvres qui se veulent furtives, éphémères, relationnelles et participatives, des travaux qui, s’ils font appel à des objets ou à des composantes matérielles – ce qui n’est bien sûr pas toujours le cas – , présentent une économie de moyens certaine et ne laissent que peu de traces dans le territoire. En revanche, ces manifestations seront relayées dans le cyberespace, où elles continueront leur parcours, suivant d’étonnants détours parce que les internautes, se saisissant des images publiées dans les blogues des artistes, contribueront à les disséminer. C’est le cas, par exemple, pour Karen Elaine Spencer, qui se laisse volontiers dérober les images qu’elle laisse dans ses blogues. L’activité des tricoteuses urbaines (adeptes du tricot-graffiti ou du yarn bombing) illustre aussi bien cette résonance incessante. Ces activistes tricotent pour diverses causes, parfois simplement pour réchauffer des endroits mal-aimés de la ville, comme ce fut le cas lorsque les Ville-laines ont tenté de donner un peu de réconfort à l’Agora du square Viger à Montréal. Installés précipitamment et sans permission, leurs travaux d’aiguille tendent à être rapidement retirés des lieux publics, mais leur vie se poursuit à travers de très nombreux blogues et surtout des groupes Flickr où les images se propagent et se multiplient très vite. Ainsi, tant en ce qui concerne le tricot-graffiti que plus généralement les pratiques artistiques furtives, ce qui, dans l’espace urbain, apparaît comme à peine public – soit par la brièveté de l’apparition, soit par les aspects nécessairement subreptices et confidentiels de certains gestes artistiques –, devient par le Web, beaucoup plus présent, visible, mobile et foisonnant. Les groupes Flickr, extrêmement nombreux, forment d’ailleurs des communautés de goût dont plusieurs s’intéressent à l’art et à ses objets, se rassemblant notamment autour d’œuvres d’art public, de sites ou de réalisations architecturales, de pratiques particulières comme le street art dans toutes ses déclinaisons, ou prétendant eux-mêmes à l’art, rivalisant de créativité photographique dans des pages où s’exposent des photos faites selon des règles spécifiques, comme par exemple « Lieux ou choses qui ont été abandonnés »4.
Alors que les cybernautes font circuler les images d’œuvres d’art et les images de la ville, bien des artistes, autre forme de correspondance, intègrent des dispositifs techniques dans le tissu urbain. Les écrans, grands et petits, les projections, les instruments de géolocalisation – sans parler des caméras de surveillance et autres appareils plus ou moins dissimulés – sont devenus choses courantes dans l’espace public urbain, qu’ils soient d’usage coutumier, à fonction de divertissement ou d’intention artistique. Les marches sonores et les promenades vidéo, à l’instar de celles de Janet Cardiff, introduisent dans l’espace public des appareils portables permettant une expérience personnelle très forte d’un/dans un lieu public. Un continuum se crée entre enregistrement et espace réel, entre motifs techniques et spatiaux, entre passé et présent, et de multiples réseaux superposant ou intriquant les spatio-temporalités se mettent en place, ramenant le passé vers le présent, ou l’ailleurs vers l’ici – ainsi que le faisaient déjà des techniques plus anciennes comme la photographie –, tout en complexifiant l’expérience : de nombreux appareils infiltrés dans les espaces publics de la ville produisent des effets de va-et-vient répercutant les déambulations de spectateurs devenus actifs dans des lieux eux-mêmes démultipliés. Des villes entières – comme c’est le cas de Markham en Ontario au cours du projet Land/Slide: Possible futures – peuvent ainsi être conquises par les artistes. Ceux-ci usent de toutes sortes de procédés et de médias numériques, aux fins de ménager dans la ville et ses lieux des temporalités ouvertes : envahissant le présent d’un site historique et donc chargé de passé, les artistes y font exister, serait-ce temporairement, des passés insoupçonnés, d’autres possibles présents et des futurs insolites auxquels les visiteurs peuvent se mêler.
Ces manières de faire, dans l’espace public urbain tout aussi bien que dans le cyberespace, partagent un trait commun, celui de la (volonté de) formation de communautés par l’échange et la participation, apparemment typique du Web 2.0 que l’on définit comme le lieu du user-generated content et de la collaboration de masse. Symétriquement, Giovanna Borasi a récemment proposé l’idée d’une « version 2.0 » de la ville parce que, de plus en plus, des actions de citoyens et d’artistes, initiatives singulières ou communautaires, « introduisent dans l’espace urbain un nouveau dialogue entre l’acteur individuel, le groupe, la masse, etc. »5 ; une conversation éventuellement vouée à se poursuivre, à être réfléchie et à trouver de nouveaux instruments et des réseaux supplétifs dans le Web.
Cependant que les artistes, par des dispositifs technologiques, insèrent dans les villes des temps historiques, des visions du futur, des fictions et des utopies, l’espace urbain est entièrement quadrillé pour ensuite être mis à disposition dans le cyberespace par des entreprises qui semblent s’être donné pour objectif de mettre en images tous les lieux du monde. Google Earth et Google Street View sont des systèmes à base d’images numériques fixes, que l’on pourrait donc décrire comme des photographies, bien que l’internaute ait l’impression de pouvoir s’y mouvoir parce qu’ils sont interactifs. On peut user de ces systèmes comme de cartes en trois dimensions, afin de se repérer ou de tracer des itinéraires, mais ils peuvent également être utilisés comme l’étaient les séries d’images produites au XIXe siècle, ou bien les cartes postales photographiques, pour voir le monde et en collectionner tous les aspects, toutes les vues… Grâce à Google Earth également, les photographes amateurs qui téléchargent leurs images dans le site Panoramio (« Share and explore the world in photos »6) les voient apparaître, incrustées dans la vue satellitaire, comme autant de petites vignettes faciles à agrandir en y faisant glisser le curseur. La photographie de voyage, auparavant réservée au visionnement domestique acquiert, grâce à ces outils, une visibilité mondiale, pendant que les photographes internautes se donnent l’impression d’occuper une parcelle du monde, en y accrochant l’image qu’ils en ont faite. Ces sites et systèmes, et cela n’était peut-être pas prévu par leurs promoteurs, permettent également un équivalent fort passionnant de la déambulation urbaine, que pratiquent avec bonheur certains artistes.
Dans le Web on le sait, les domaines public et privé s’interpénètrent et se confondent de plus en plus. Les dynamiques de l’art d’élite et celles de la culture de masse tendent à évoluer de façon analogue […] De même, l’espace urbain et le cyberespace se considèrent de plus en plus en résonance l’un à l’autre, les actions entreprises d’une part se trouvant prolongées ou rendues publiques d’autre part, souvent par le biais d’images photographiques.
La déambulation et la marche, aussi bien que la « construction de situations », ont été proposées il y a déjà longtemps comme autant de façons de réinventer le quotidien, voire de le détourner. L’objet premier de ces réinventions et de ces possibles actions de détournement, d’abord imaginées par les situationnistes et plus tard par Michel de Certeau, était l’espace urbain. Les pratiques urbaines, furtives, relationnelles, in situ et éphémères dont il a été question plus haut continuent ou perpétuent ces traditions ; et celles-ci trouvent aussi, fort heureusement, d’autres échos dans le cyberespace. Dans la ville on détourne des lieux, dans le cyberespace ce sont des images et des sons que l’on distrait de leur usage ou de leur site premier, pour leur donner une autre existence, les faire voir et entendre ailleurs, soit dans le Web, soit dans des espaces publics plus « concrets » que leur premier séjour, en des séries remontées autrement, ouvrant du coup des perspectives ludiques, mais plus souvent critiques, sur un matériau abondant qui, reformulé ou réassocié à nouveaux frais, raconte des histoires singulières. C’est le cas des sélections, aléatoires ou pas, que pratiquent certains artistes comme Grégory Chatonsky – souvent à l’aide de logiciels qu’ils ont eux-mêmes bricolés –, ou des séquences vertigineuses de photographies d’amateurs qu’assemble Dina Kelberman. C’est aussi le cas de Dominic Gagnon qui, avec du matériel récupéré alors qu’il fait l’objet de censure dans YouTube, fabrique ses films, les compose à l’aide de ces bouts de vidéo fugitifs. Les images ainsi vont et viennent, disparaissant parfois parce que jugées inadéquates, et bien des promeneurs du Web s’en emparent, prolongeant ainsi leur vie. Il en va de même pour Jon Rafman, ce marcheur nouveau genre errant à travers Google Street View comme dans des villes bâties d’images planes dans lesquelles on croit pénétrer alors qu’elles glissent devant nous. S’en saisissant comme on le ferait d’instantanés de voyage, il les redonne à leur état premier, celui d’images fixes. Tous ces gestes sont proches de ce que de Certeau a qualifié de braconnage, l’une des « mille pratiques par lesquelles des utilisateurs se réapproprient l’espace organisé par les techniques de la production socioculturelle »7, un propos qui reste étonnamment d’actualité lorsqu’il s’agit du cyberespace.
Il est très ironique de rappeler qu’on a voulu, pour distinguer la photographie – une mécanique reproduisant les choses comme automatiquement – des images véritablement artistiques comme la peinture, discriminer les gestes ou les actes qui les font naître, entre le prendre et le faire. Depuis les années 1960, et souvent grâce à des caméras d’amateurs comme l’Instamatic de Kodak, les artistes eux-mêmes, pourtant, prennent plus souvent qu’ils ne font. Et le cyberespace comme d’autres médias, au même titre que la ville ou d’autres territoires, est devenu pour eux un espace de déambulation où ils peuvent capter, saisir des images. La proposition énoncée par Douglas Huebler en 1968, « The world is full of objects, more or less interesting. I do not wish to add any more. », devient aujourd’hui un mode de conduite artistique généralisé, de sorte que les photographes amateurs internautes produisent vraisemblablement de plus grandes quantités d’images nouvelles que les artistes. Mais, soulignons-le, les amateurs semblent eux aussi friands d’appropriation, de captation d’images déjà faites ; ils s’emparent même, et ce phénomène risque lui aussi de prendre de plus en plus d’ampleur, des images des artistes, souvent pour les remixer, parfois pour en offrir leur propre interprétation ou reenactment…
Toutes ces actions et interactions, ces manières de faire et ces réciprocités composent un espace public comme augmenté ou dilaté, interconnecté, multiple et composite. Et, dans cet espace par lequel semblent devoir se lier les deux acceptions qui ont été tenues plus ou moins séparées de la sphère publique – lieu d’échanges et de débats, plutôt politique et relativement immatériel ou dé-spatialisé – et d’espaces publics physiques et situés, il pourrait devenir difficile de distinguer l’art du non-art. Considérant toutes ces actions de prise et de sélection, d’appropriation, de détournement, de dérivation, de multiplication, d’agencement et de montage, comment, en effet, peut-on encore revendiquer la propriété des images, s’en déclarer l’auteur ? Joan Fontcuberta n’affirmait-il pas, il y a peu de temps, dans les pages mêmes de cette revue (CV, n° 93, hiver 2013), faisant lui aussi écho au propos de Huebler, « je pense que la question du statut de l’auteur, du créateur, impose une réponse environnementaliste, écologiste : il faut cesser de produire de nouvelles images et, plutôt, récupérer et recycler des images déjà existantes… » ; et, soutenait également Fontcuberta, « notre seul espoir réside dans la photographie sans qualités, faite par les amateurs dans les domaines du vernaculaire » ; un matériau dont bien des artistes se sont saisis en effet.
L’extrême circulation des idées et des images a, semble-t-il, signé l’entrée dans une nouvelle phase de l’économie capitaliste, que Jeremy Rifkin a qualifiée d’« âge de l’accès », où les entreprises contrôleraient et réguleraient l’accès à toutes choses. Mais, en même temps, des mondes communs se sont ouverts, de nouvelles tactiques de résistance ou de braconnage se sont fait jour. Car, comme l’a fait remarquer Lev Manovich8, si la culture du remix et le Web 2.0 s’inscrivent d’une certaine façon en prolongement des manières de faire des habitants des villes identifiées par de Certeau, c’est leur dynamique et leur énergie propres, leur aspect imprédictible, qui poseront un véritable défi à l’art.
1 Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », L’obvie et l’obtus. Essais critiques 3, Paris, Seuil, 1982, p. 35-36. Cet essai a d’abord été publié dans la revue Communications en 1964.
2 Francis Jauréguiberry, « De l’appel au territoire comme effet inattendu de l’ubiquité médiatique », Espaces et sociétés, n° 74-75, 1993. p.117-133.
3 Éric Michaud, « Daguerre, un Prométhée chrétien », Études photographiques, n° 2, mai 1997, p. 57.
4 http://www.flickr.com/groups/abandoned/. Consulté le 7 avril 2013. Il est à noter que la dissémination des images publiées dans des blogues ou dans Flickr est souvent favorisée par l’usage de licences Creative Commons.
5 Giovanna Borasi, « Ville 2.0 », Actions : Comment s’approprier la ville, sous la direction de Giovanna Borasi et Mirko Zardini, Centre canadien d’architecture, 2008, p. 25-26.
6 http://www.panoramio.com/. Vérifié le 7 avril 2013.
7 Michel de Certeau, L’invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990, p. XL.
8 Lev Manovich, « Art after Web 2.0 » dans Rudolf Frieling (dir.), The art of Participation: 1950 to Now, San Francisco, San Francisco Museum of Modern Art / Thames and Hudson, 2008, p. 78.
www.ville-laines.blogspot.ca/2011/11/square-viger-mission-accomplie.html
www.flickr.com/photos/snweb/with/12379604/
www.blog.flickr.net/en/2013/02/22/thomas-hawk-im-trying-to-capture-1-million-photos-before-i-die/
www.chatonsky.net/projects/all-these-images/
www.dinakelberman.tumblr.com/
www.flickr.com/photos/bridgelucey/4204404969/in/photostream/
Suzanne Paquet est professeure au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal. Elle s’intéresse à la sociologie de l’art et aux études photographiques, de même qu’aux arts de l’espace : art environnemental et land art, paysage, architecture et urbanisme. Elle poursuit depuis quelques années des recherches relatives à la circulation des images et à l’inscription de certains types d’art dans le façonnement de l’espace ; dans ces recherches, une grande importance est accordée à la réciprocité espace public urbain et cyberespace. Elle a notamment publié Le paysage faconné. Les territoires postindustriels, l’art et l’usage (2009), dirigé le dossier thématique « Reproduire » de la revue Intermédialités (no 17, 2011) et l’ouvrage collectif Le paysage, entre art et politique (2013).