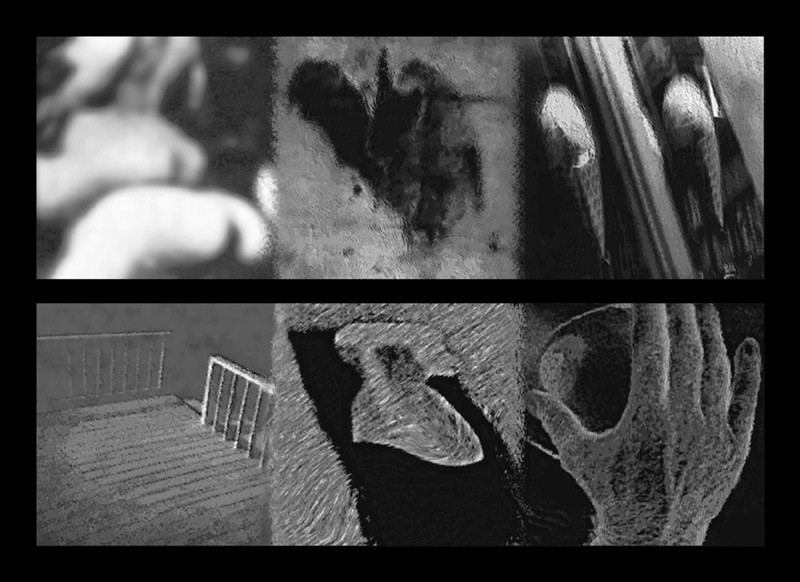[Automne 1999]
par Mona Hakim
Faire le bilan de la photographie québécoise des années 90 est un projet quelque peu casse-cou. Le sujet mérite une analyse approfondie quant à ses développements et ses enjeux avec un recul qu’il n’est pas certain que nous possédions.
Pas question d’une étude théorique donc, là n’était d’ailleurs pas le but, plutôt des pistes de réflexion, des points de vue délimités par un œil attentif au vaste répertoire des pratiques et des discours.
Pour la photographie, les années 90 ont été généreuses. Ne pas ressentir son impact, pour quiconque s’intéresse à l’art contemporain, serait faire preuve de mauvaise foi. Les centres d’artistes voués exclusivement à la photographie tels que VOX, Vu, Dazibao et Séquence tiennent toujours efficacement le cap, intensifiant la diffusion d’artistes québécois à l’étranger et vice versa. De leur côté, les musées, les autres centres d’artistes, le Centre International d’Art Contemporain et l’arrivée du Musée canadien de la photographie contemporaine en 1992 ont également contribué à faire la part belle à la photo. Depuis peu certaines galeries commerciales, quoiqu’avec parcimonie, semblent s’ouvrir au médium, et c’est tant mieux. Universités et Cégep se sont mis de la partie élargissant leur programme multidisciplinaire avec emphase sur la photographie. Y aura-t-il suffisamment d’espaces de diffusion pour tous ces nouveaux mordus de la photo ?
On n’oublie pas de mentionner bien sûr Le Mois de la Photo à Montréal, événement biennal qui, depuis 1989, ratisse littéralement la ville. On pourrait certes reprocher le caractère devenu institutionnel de l’événement. Cependant, l’essor de la photographie au Québec tient pour une bonne part à cette biennale dont le principal mérite, outre sa capacité à intercepter les grands axes de l’actualité photographique, est de nous avoir positionnés sur l’échiquier international aux vues et sus du grand public. Un public par ailleurs toujours avide de ces événements phares et dont le Québec semble vouloir faire une spécialité. Ne serions-nous pas prêts toutefois pour circonscrire des expositions du même calibre, hors événement, à un rythme plus fréquent ? Voilà une des questions sur lesquelles nous devrions peut-être spéculer dans les années à venir.
Du côté des publications spécialisées sur le médium, il revient aux catalogues d’exposition, qui se sont nettement multipliés, d’avoir comblé les lacunes. Depuis Photo-sculpture (1991)1, La traversée des mirages (1992)2, De la curiosité, Petite anatomie d’un regard (1992), les deux excellentes éditions de la revue Plaques sensibles (1992-1993)3, jusqu’aux livres-essais publiés par Dazibao depuis 19964, en passant par les catalogues du Mois de la Photo à Montréal et par la revue CVphoto, restée fidèle à son mandat de lier rigueur et vulgarisation, pour ne nommer que ceux-là, la photographie s’est dotée depuis les années 80 d’un discours théorique sans précédent. Bien que s’y infiltre parfois un certain hermétisme, il s’agit, est-il besoin de le dire, d’outils d’analyse, de recherche et de diffusion essentiels pour l’avancement du médium. Là où réside le piège en fait, est dans l’emprise que peut avoir ce discours sur certaines pratiques artistiques, celles-ci (et il y en a quelques unes) lui étant par trop assujetties.
D’un point de vue plus esthétique cette fois, on peut difficilement parler de la photographie des années 90 sans faire un retour sur la décennie qui l’a précédée. Au moment où la photographie s’est éloignée du documentaire, où elle a découvert le pouvoir subjectif du photographe alors que celui-ci se mettait à considérer son espace intime. Au moment où l’histoire du médium, la découverte de son propre langage, son indépendance par rapport au réel ont bouleversé notre façon de reproduire le monde. Dorénavant, « Ce n’est plus (la) présence (du monde) qui nous sollicite, avait déjà souligné Sylvain Campeau, ce sont ses effets. Et la photographie se propose comme captation d’effets »5. Cette période postmoderne, on le sait, a entraîné avec elle une photographie hybride, métissée, contaminée, manipulée, fréquentant dorénavant le domaine des arts plastiques et visuels. Des œuvres qui associent « …le photographique aux résultats d’un “imaginaire d’action” par lequel on reconnaîtra la prépondérance du faire et du savoir faire » dira Gaétan Gosselin dans son bilan de la photographie des années 806.
Ce détour temporel est nécessaire, car la production des années 90 se situe bel et bien dans l’axe de la continuité et non de la rupture (comme ce fut le cas dans les années 80). Pour les précurseurs de cette reformulation du regard photographique, les années 90 ont d’abord permis à plusieurs d’entre eux d’accéder, ici comme à l’étranger, à la reconnaissance qu’ils méritaient. Pendant que les uns profitaient d’une visibilité sur la scène internationale, d’autres bénéficiaient de la popularité actuelle des expositions-bilan d’artistes «mature» qu’ont encouragé certains musées ou des lieux comme le CIAC.
On connaît bien maintenant les catégories esthétiques qu’a généré le travail, entre autres, des Michel Campeau, Raymonde April, Holly King, Alain Paiement, Roberto Pellegrinuzzi, Jocelyne Alloucherie, Geneviève Cadieux, Denis Farley, Serge Tousignant, Richard Baillargeon, Angela Grauerholz. Si, dans leur propre production, l’autoportrait, la narration, la mise en scène, les jeux sur le dispositif optique, le déploiement installatif se sont consolidés et étoffés dans les années 90, ces tendances ont aussi et surtout permis d’ancrer des balises sur lesquelles se constituent et se confrontent tout un pan des pratiques photographiques et théoriques actuelles.
Bien qu’aujourd’hui les cloisons thématiques ne soient plus aussi étanches, il est clair que ces mêmes espaces narratifs, autobiographiques, installatifs et autres, parcourent éminemment l’ensemble des années 90, s’entrecroisent et créent un réseau d’influences multiples et hétérogènes. Chez une artiste comme Anne-Marie Zeppetelli, à titre d’exemple, l’autoportrait est affaire de mise en scène fantasmatique et construite devant le viseur de l’appareil, alors que chez Andrea Szilasi, l’autoportrait n’est plus de l’ordre du récit, mais s’investit dans une trame matérielle, i.e. à même le corps physique de l’image.
Il serait vain de tenter de prélever les thèmes clés de la décennie tant ceux-ci sont éclatés. Bien sûr la quête de soi via la représentation du corps ou la construction d’un récit personnel, l’investigation de paysages topologiques, les espaces mnémoniques, médiatiques et oniriques soutiennent inlassablement les préoccupations des artistes. C’est d’ailleurs à travers un intérêt marqué envers l’espace physique que la photo-sculpture, l’installation ou le grand format ont pris en charge ces mêmes thèmes, plus fortement au début de la décennie. Outre les Pellegrinuzzi, Paiement, Alloucherie, Farley, Cantin se sont joints les Mireille Baril, André Clément, Thomas Corriveau, Stephan Ballard, Yves O’Reilly. Lors de l’édition 1993 du Mois de la Photo, Marcel Blouin avait déjà souligné, à juste titre, la portée de cette « spatialité »– j’ajouterais la mise en scène – comme ce qui semblait être pour lui « une des rares spécificités de la photographie contemporaine québécoise et canadienne »7.
La propension à la construction/déconstruction, à l’exploitation d’une identité fragmentée et d’un détournement indiciaire a trouvé une voie tout aussi prégnante dans des pratiques qui investissent l’image bidimensionnelle comme un réel à bricoler. France Choinière, Jacki Danylchuk, Eugénie Schinkle, Andrea Szilasi, Nathalie Caron font partie de ceux qui interviennent sur l’image de manière tactile, cherchant à matérialiser un réel qui n’est plus celui de l’image captée mais bien celui qu’elles ont elles-mêmes construit. Alors que Szilasi trame son propre corps à même les lanières ciselées du support papier, Schinkle découpe en mille morceaux un paysage qu’elle reconstituera à la manière d’un peintre pointilliste ou d’un mosaïste. Dans les deux cas, l’œil se perd dans les dédales de la matière et du sujet l’obligeant à un détour fictionnel.
Il en va de même chez Nathalie Caron, que l’on peut considérer comme une représentante accomplie non seulement de ces plasticiens de la photographie mais des artistes multidisciplinaires (elle est aussi poète et performeuse) et des créateurs de récits au quotidien. Ces œuvres à caractère autobiographique sont parfois cousues de fils d’Ariane (au propre et au figuré), comme des sutures d’un réel morcelé. S’y greffent des poèmes personnels ou d’autrui et des images dont on ne sait lesquelles sont empruntées. Le métissage formel et temporel des œuvres de Caron fait entrave à une logique illusionniste de la photo pour entrer précisément dans un temps narratif fictionnel.
En donnant corps à l’image, le but premier des approches plus plasticiennes de la photographie est non seulement d’exalter le geste et donc la subjectivité de l’auteur, mais aussi de maintenir cette fameuse distance par rapport à la représentation photographique. Dans cette même visée, s’inscrirait l’utilisation par nombreux artistes (dont Caron, Schinkle, Szilasi) d’images préexistantes, récupérées et manipulées, que l’on dit images secondes, celles-ci se butant à une logique temporelle autant qu’analogique. Le phénomène est marquant dans certaines images d’Angela Grauerholz chez qui le flou photographique opacifie la surface pour mieux suspendre le temps, nous renvoyant en quelque sorte à l’ici/maintenant de l’image. Les images de seconde main circulent éminemment, quoique dans des registres différents, chez les Emmanuel Galland, Samuel Lambert, Céline Baril, Lucie Duval, Richard Baillargeon, Carol Dallaire, pour ne nommer qu’eux.
Le procédé d’emprunt n’est pas sans rappeler l’intrusion du document d’archive chez des artistes comme Sorel Cohen, Nicole Jolicœur ou Sylvie Readman. Là réside d’ailleurs une facette intéressante de la photographie en tant que document, sertie ici d’une forme de théâtralité.
Et puis il y a l’apport des nouvelles technologies, tendance fétiche des années 90 s’il en est une, cheval de bataille des intervenants du Mois de la Photo à Montréal qui, dès 1993, ont manifesté leurs positions théoriques sur le sujet jusqu’à l’exposition phare de 1997 : Photographie et immatérialité. C’est bien « l’observation des changements de perception de la réalité par l’humain »8 que remet en question le rapport de la photographie avec les technologies. Et c’est tout autant la mise à mal de la théorie barthienne, certainement la plus sévère, qu’il faut retenir de cette nouvelle alliance. Une mise à mal dont les répercussions sur les autres types de productions photographiques ne peuvent d’ailleurs être ignorées.
Certes ce sont les manipulations d’images par procédé numérique qui ont entraîné la seconde forme de bouleversement par rapport à la saisie du médium. Une numérisation dans laquelle se sont engagés, chacun à leur manière, des artistes comme, entre autres, Marcel Blouin, Ginette Daigneault, Lucie Lefebvre, Ginette Bouchard, Pierre Guimond. Or plus percutantes, voire perturbantes m’apparaissent les productions totalement détachées de leur référent (ce qui n’est pas le cas chez les tenants actuels du numérique), et que permettent les images de synthèse et les images interactives. Bien que le discours en fasse largement mention, ce type d’approche est toutefois plus ou moins présent dans la photographie québécoise (si nous pouvons encore parler de photographie à ce stade). Certes les artistes de la vidéo et du multimédia vont relativement loin en ce sens9, mais du côté de la photographie, Carol Dallaire semble tenir à peu près seul la barre. Dallaire manie les espaces réel, fictif et virtuel, prélevant des images à même différents supports (dont internet), y intercalant des bribes de textes pour en arriver à des histoires imagées rocambolesques et entièrement inventées.
La filiation entre médiums variés donne par ailleurs des résultats probants chez les photographes fréquentant la vidéo. Parmi eux, on retiendra les Jacques Perron, Ariane Thézé, Michèle Waquant, Donigan Cumming. Intéressés aux expériences de la durée, aux tensions entre fixité et mobilité, leurs préoccupations ne sont pas si loin de celles que soulèvent l’immatérialité des images, ou leur « minceur »10.
Je m’en voudrais de conclure sans souligner ici l’apport d’un artiste comme Alain Paiement, dont le travail m’apparaît exemplaire de la filiation entre les voies photographiques des deux dernières décennies. En tant qu’artiste multidisciplinaire (peinture, sculpture, photo), Paiement fut au cœur même des premières connivences entre les arts plastiques et la photographie, à l’origine des photo-sculptures et photo-installation, des jeux optiques propres au dispositif et un familier des images numérisées (dès le début des années 90, on a tendance à l’oublier). Depuis Waterdampstrukturen (1985) jusqu’à son tout dernier projet réalisé à Contretype (Bruxelles) portant sur les façades « symptomatiques » d’une ville en transformation (1998-99), se sont entrecroisés les espaces géographiques et architecturaux, l’échelle monumentale, l’in situ, les points de vues pluridirectionnels et surtout critiques à l’égard des excès d’une société postmédiatique. Un travail que l’on aurait tout intérêt à revisiter.
En conclusion ? La jeune génération ? Pas tout à fait différente de ses aînés en ce sens qu’elle ne réfute pas la continuité. Or si elle s’inspire de ses prédécesseurs, elle le fait plus librement, se jouant des catégories et des idéologies strictes, et semble se distancer des dogmes de la déconstruction. Cette génération, dont plusieurs se déclarent d’abord artistes avant d’être photographes, artistes sans discipline fixe (pour emprunter un beau terme de Louise Poissant), explore les espaces élargis de la photo, lucide et sans fausse pudeur. Parmi eux, Carl Bouchard, Lucie Duval, Emmanuel Galland.
Pour une bonne part de la nouvelle production, les motivations puisent dans les croyances naturalistes, les données brutes du réel, les espaces domestiques, introspectifs ou poétiques et les latitudes fournies par le hasard et le spontané. Yan Giguère, pour ne nommer que lui, serait un digne représentant de ces formes de plus en plus répandues du néo-document. Émule en somme des Nathalie Caron, Angela Grauerholz, et surtout Raymonde April. April étant très certainement la figure de proue d’un large pan de la photographie québécoise.
Bricolage, document, archive, installation, vidéo, technologie. Et si c’était une décennie sans direction fixe…
1 Catalogue d’une exposition organisée par Les Studios d’été à Saint-Jean-Port-Joli et présentée à Montréal à la galerie Oboro et Optica en 1991.
2 Catalogue d’une exposition présentée dans la Région Champagne-Ardenne et organisée par l’Association Transfrontières et le centre Vu, Québec, 1992.
3 Plaques sensibles fut éditée par Les herbes rouges. Les deux numéros proposaient un bilan théorique et analytique de l’année photographique en cours. On regrette la courte vie de cet outil de recherche inestimable.
4 Portrait d’un malentendu. Chroniques photographiques récentes, 1996 ; De la minceur de l’image, 1997 ; La face. Un moment photographique, 1998.
5 Sylvain Campeau, Plaques sensibles 1, Montréal, Les herbes rouges, 1992, p. 9.
6 Gaëtan Gosselin, La traversée des mirages. Photographie du Québec, Québec, Transfrontières de Champagne-Ardenne et Vu, 1992, p. 11.
7 Marcel Blouin, Présentation, catalogue Le Mois de la Photo à Montréal, Montréal, Vox Populi, 1993, p. 7.
8 Marcel Blouin, L’éternel et l’éphémère, catalogue Le Mois de la Photo à Montréal, Montréal, Vox Populi, 1997, p. 12.
9 Voir à ce sujet le dossier sur les arts électroniques et leurs enjeux esthétiques dans Etc. Montréal, n° 46, été 1999, pp. 6-25.
10 Je fais référence à De la minceur de l’image, intitulé d’une exposition et du livre-essai qui l’accompagne, de Nicole Gingras, présentée et édité chez Dazibao, Montréal, 1997.
Mona Hakim vit et travaille à Montréal. Elle enseigne l’histoire de l’art au CEGEP André-Laurendeau. Critique d’art, elle écrit pour plusieurs revues en art visuel dont Parachute et CVphoto et a collaboré à de nombreux catalogues d’exposition. À titre de commissaire, elle prépare présentement une exposition en collaboration avec Sylvain Campeau portant sur la photographie québécoise des 15 dernières années. L’exposition est prévue pour le Centro de la Imagen de Mexico en mars 2000, 1ère étape d’un parcours qui devrait se terminer à Montréal en 2001. Ce projet a été initié par Lili Michaud, directrice de la galerie Occurrence.