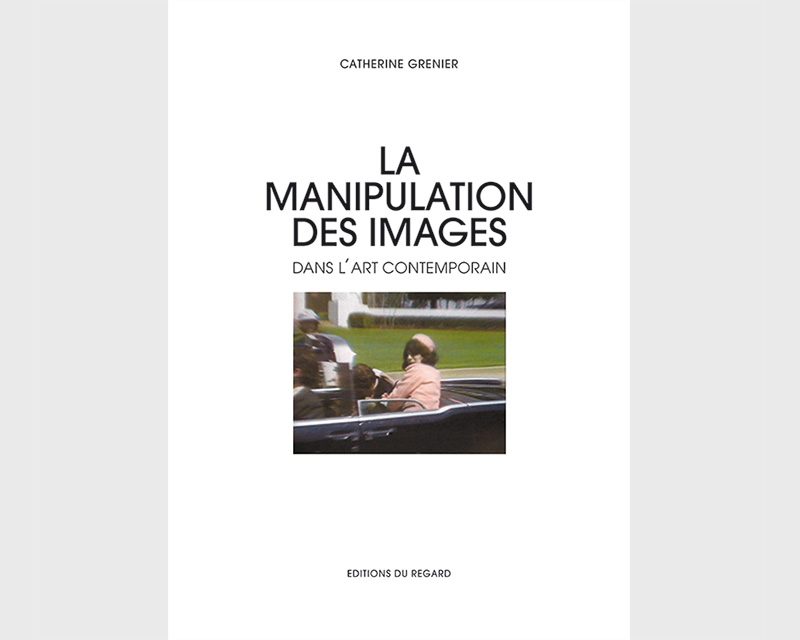La manipulation des images dans l’art contemporain
Falsification, mythologisation, théâtralisation
Catherine Grenier
Paris, Les Éditions du regard, 2014, 192 p., ill.
Par Anne Bénichou
Jusqu’à récemment directrice adjointe au Musée national d’art moderne, maintenant aux rênes de la Fondation Alberto et Annette Giacometti, Catherine Grenier publie un essai intitulé La manipulation des images dans l’art contemporain. Falsification, mythologisation, théâtralisation. Malgré son titre, l’ouvrage ne traite pas strictement des oeuvres qui relèvent de l’image, mais de l’ensemble des pratiques artistiques des deux dernières décennies. Qu’elles soient vidéographiques, filmiques, picturales, photographiques, mais aussi sculpturales, installatives, performatives, toutes sont travaillées par l’image, soit parce qu’elles s’approprient des images existantes ou en reprennent les modes de production, ou bien parce qu’elles sont destinées à faire image. Selon Grenier, les images sont « invasives » ; elles sortent de leur cadre, « basculent dans le monde réel » pour être « habitées » de maintes façons. En contrepoint du tournant linguistique de l’art conceptuel des années 1960, l’art du début du XXIe siècle relèverait d’un régime généralisé de l’image. C’est la thèse que défend Grenier, remettant ainsi la mimêsis et ses rapports au réel et à la fiction au coeur de la réflexion sur l’art contemporain.
L’auteure distingue trois stratégies caractéristiques de ce régime iconique renouvelé. La falsification, à laquelle elle consacre les deux tiers du livre, est de l’ordre du faux-semblant. Grenier y associe trois types de pratiques, le remake, le reenactment et la fabrication de faux témoignages, chacun faisant l’objet d’un chapitre. La deuxième stratégie, la théâtralisation, procède de « l’image performative », qui excède la bidimensionnalité pour se déployer sous la forme du tableau vivant ou de la mise en scène. Enfin, le chapitre qui clôt l’ouvrage aborde la « mythologisation », soit « le retour à l’essentiel », les « stratégies du moins ». Grenier procède par nomenclatures, structurant chaque chapitre à l’aide de séries d’intertitres qui lui permettent de regrouper les pratiques artistiques selon les affinités des procédés mis en œuvre.
De nombreux artistes reprennent la tradition cinématographique du remake en exploitant les techniques propres au septième art. Grenier décline les différentes modalités d’investigation des œuvres originales que ces reprises permettent : interroger le réel que le film est censé restituer ; explorer la réalité du tournage plutôt que la fiction du film ; donner forme à des séquences non réalisées ou au « film évoqué dans le film » ; étirer ce qui ne dure que quelques fractions de seconde ; montrer l’entre-deux des images ; démultiplier les phénomènes d’identification entre héros, spectateurs, réalisateurs des films originaux et auteurs des remakes. Ces déplacements ont des visées très différentes. Ils répondent à des quêtes personnelles ou à un désir de rendre universel un imaginaire individuel et singulier. Ils permettent d’explorer le pouvoir qu’a le cinéma de façonner les imaginaires collectifs et les figures héroïques. Certains artistes travaillent le remake en croisant la culture cinématographique et la performance. Cette hybridation permet des interprétations outrancières qui desservent des questionnements sur le genre et les politiques des représentations identitaires.
Les reenactments et les restagings consistent à remettre en scène des actions, qu’il s’agisse d’œuvres performatives du passé ou d’évènements historiques. Les artistes s’inspirent du modèle des reconstitutions historiques effectuées par les associations d’amateurs. Ils ébranlent la notion traditionnelle d’original et refaçonnent les liens entre la performance et l’image. Les performances du passé qui n’ont jamais été documentées se dotent d’un « potentiel image », d’une « capacité de communication imaginative ». L’énoncé oral de l’action a désormais le pouvoir de faire naître une image. Quant aux captations des performances historiques, après avoir migré du statut de document à celui d’œuvre d’art, elles se voient à nouveau déqualifiées par les reconstitutions filmées qui les supplantent. Dans ce processus, l’authenticité et l’historicité de l’image de performance perdent de leur primauté. Ces « répétitions créatives » sont devenues, selon Grenier, une véritable méthode de création. Les artistes utilisent désormais les modèles comme répertoire.
Les reconstitutions d’évènements historiques sont également destinées à faire image. À travers elles, les artistes s’adonnent à une déconstruction des représentations historiques et à un dialogue entre le présent et le passé. Le faux devient un moyen d’approcher une certaine vérité historique et surtout de la problématiser : la dérive du sens qu’opèrent les réécritures de l’histoire, la dimension falsificatrice de toute reconstitution historique, l’anachronisme particulièrement criant dans les reconstitutions en costumes d’époque. La quête de vérité est abordée de façon plus frontale par les artistes, de plus en plus nombreux, qui s’approprient les techniques et les méthodes sophistiquées des experts médico-légaux. L’enquête constitue, selon Grenier, un véritable « schéma modélisateur » pour les artistes.
Alors que les tenants du remake et du reenactment recourent au faux délibéré, d’autres s’inscrivent dans la tradition du documentaire et privilégient des œuvres dotées d’un « bas coefficient artistique » qui semblent miser sur les valeurs testimoniales et didactiques du document. Cette « nouvelle esthétique documentaire » reformule toutefois les rapports entre les dimensions descriptives et esthétiques de l’image. Les artistes explorent les possibilités de produire un document en recourant à tous les artifices disponibles ou en investissant l’écart entre le réel et le simulacre. D’autres usent du témoignage, de l’archivage et de la cartographie pour interroger la construction des récits historiques et privilégier des formes non évènementielles de l’histoire, à la manière des nouveaux historiens.
Le chapitre consacré à la « théâtralisation de l’image » traite des installations performatives qui réinvestissent les liens entre le théâtre et les arts visuels. Les artistes exploitent tous les artifices scénographiques : décors, reconstitutions architecturales, costumes, accessoires, mannequins, apparitions fantomatiques, etc. Ils « mettent en scène la mise en scène », selon un redoublement qui relève d’une posture critique. Ces installations performatives sont présentées actives, inactives, ou accompagnées d’une vidéo témoignant des actions qui s’y tiennent. Les artéfacts qui les composent sont non pas réduits à des reliques d’une action passée, mais dotés d’une potentialité. Leur temps est celui de « l’advenir », du futur. Elles reposent sur un paradoxe : le renouvellement perpétuel et l’incomplétude.
La manipulation des images convoque un nombre impressionnant de pratiques artistiques actuelles, issues de scènes diversifiées, et témoigne d’un regard informé, attentif et polyvalent. L’ouvrage n’évite toutefois pas l’énumération, parfois la liste nominative. Les analyses d’œuvres sont souvent trop courtes et les développements théoriques, trop rapides. On peine à comprendre l’usage de la notion de « mythologisation » que l’auteure emprunte à Roland Barthes et la cohérence des œuvres qu’elle regroupe sous cette dénomination. Grenier démontre un souci de contribuer aux histoires de l’art dans leurs formes plurielles. Son regard est nourri des approches postcoloniales, féministes, queer, ouvert aux scènes plus périphériques, à certaines pratiques culturelles extra-artistiques. Forte de son expérience dans les musées, l’auteure prête attention à l’impact qu’ont les expositions et les modes de collection institutionnels sur les pratiques et les discours. On s’étonne de l’impasse sur les performance studies si déterminantes pour penser le reenactment et les liens entre le performatif et l’image.
Bien que riche, le livre ne parvient pas à caractériser les pratiques actuelles en regard de celles qui les ont précédées. Comment le régime généralisé de l’image et de la reprise qu’identifie Grenier, véritable « cannibalisme » propre au XXIe siècle, se distingue-t-il des pratiques d’appropriation qui ont marqué le glissement du moderne au postmoderne et qui n’ont cessé de se renouveler ? Rosalind Krauss mettait en pièces la notion d’originalité et envisageait le postmoderne sous le règne de la copie et de la répétition. Pour Jean Baudrillard, le simulacre apte à engender des chaînes infinies d’autres simulacres anéantissait l’idée d’une réalité première. Craig Owens percevait dans l’art postmoderne une impulsion allégorique se manifestant par le surgissement d’un passé fragmenté dans le présent. Avec Pictures, Douglas Crimp identifiait dans les images une temporalité et une présence propres au théâtre, révélant des strates iconographiques plurielles. Plus récemment, Nicolas Bourriaud proposait le terme « post-production » pour qualifier les œuvres procédant de la manipulation de matériaux de seconde main. « Reprogrammer les œuvres existantes », « habiter des styles et des formes historisés », « utiliser la société comme un répertoire de formes », écrivait-il déjà en 2004. Pourquoi ne cesse-t-on de reformuler les termes de cette fièvre appropriationniste et qu’est-ce qui se joue dans ces répétitions différenciées des discours ? Si La manipulation des images ne répond pas à ces interrogations, le livre a le mérite d’amener ses lecteurs à les penser.
Anne Bénichou est professeure d’histoire et de théorie de l’art à l’École des arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal. Ses recherches portent sur les archives, les formes mémorielles et les récits historiques issus des pratiques artistiques contemporaines et des institutions chargées de les préserver et de les diffuser. Elle a dirigé les ouvrages collectifs Ouvrir le document et Recréer/ Scripter (Les presses du réel, 2010 et 2015) et a fait paraître Muntadas. Between the Frames: The Forum (MACBA, 2011) et Un imaginaire institutionnel (L’Harmattan, 2013).