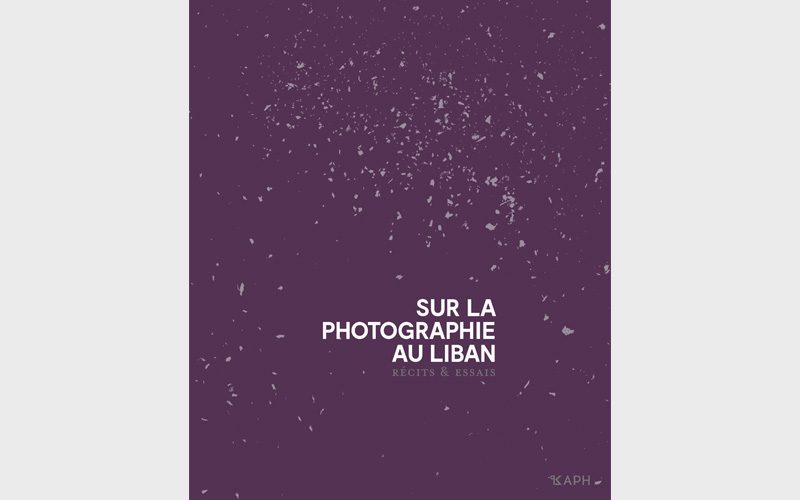[Hiver 2019]
Paris, Kaph Books – Presses du réel, 2018
Par Claudia Polledri
Le propos simple, simple et pourtant monumental, de cet ouvrage tient tout entier dans le titre : Sur la photographie au Liban. « Sur la photographie » non seulement parce qu’on y trouve une sélection époustouflante d’images photographiques allant du XIXe au XXIe siècle et issues de contextes hétérogènes. Mais aussi parce que les 40 contributions, récits et essais qui les accompagnent constituent une réflexion riche et stimulante sur la photographie en tant qu’image, pratique et technique dépliée dans ses multiples facettes. Organisée selon six axes, regardeur – opérateur – référent – objet – dispositif – transmission, la structure de cet ouvrage exprime clairement la volonté de revenir aux sources du savoir photographique et d’offrir aux non-connaisseurs les outils pour s’orienter dans un vocabulaire spécifique et les procédés techniques illustrés clairement dans l’appendice.
Face à l’ouverture offerte par l’objet photographique lui-même, dont on aborde les usages, les formes et les modes de dissémination aussi technologique, Clémence Cottard Hachem oppose une sorte de « restriction » : un corpus d’images axé sur le Liban. En réalité, il suffit de quelques pages pour comprendre que cette œuvre de territorialisation de la photographie révèle sa nature paradoxale ainsi que sa richesse. S’ancrer dans le territoire libanais signifie, en effet, ouvrir le regard sur un horizon plus large que celui des frontières géographiques et se plonger dans un tissu historique et culturel ontologiquement pluriel. C’est d’ailleurs ce qui fait la valeur de ce beau livre né « du besoin de réunir par fragments un patrimoine visuel pluriel sans tenter d’en écrire l’histoire » et, de ce fait, le rendre un peu plus accessible. On comprend alors qu’à l’image de l’histoire du pays, la photographie au Liban est intimement liée à un « ailleurs » présent à plusieurs égards, et qui agit en augmentant l’étendue géographique et culturelle des images.
C’est le cas, tout d’abord, des clichés orientalistes du photographe français Bonfils, mais aussi de Tancrède R. Dumas, Charlier, Lind, Aubin ou Rombeau et collectionnés par Gaby Daher. Installé à Beyrouth (son studio est actif en 1867), Bonfils réalise un grand nombre de ces vues amples et lumineuses de la ville transformées ensuite en cartes postales par la maison Tarazi et Terzis. Naît ainsi un nouvel objet destiné à donner forme à cet « ailleurs », un Orient envoûtant, et à permettre des usages inédits du visuel. Dans les pages d’un des albums de la collection Philippe et Zaza Jabre, la série « Voyage en Syrie, mars 1904 », qui représente, en réalité, le débarcadère et les cafés sur le quai de Beyrouth, est l’indice des multiples variations des frontières géographiques dans l’histoire. Traces d’un passé tellement lointain qu’il en paraît presque en dehors du temps, comme ce cliché de Bonfils (Palmyre, sculptures d’un chapiteau, Syrie, attribué à Adrien Bonfils, tirage sur papier albuminé, 1885–1895) et commenté par Nayla Tamraz, qui montre un enfant dormant au milieu des pierres ocre et encore bienveillantes du site archéologique de Palmyre.
Mais cet « ailleurs » qui traverse, côtoie et regarde le Liban n’est pas seulement une question géographique. Il se retrouve aussi dans la présence et le travail fondamental des photographes arméniens et de leurs nombreux studios, ou encore dans la contribution des photographes jésuites installés à Beyrouth (Gérard de Martimprey, Joseph Goudard, Louis Jalabert, Henri Lammens, Antoine Poidebard, entre autres) et dont les dizaines de milliers de documents sont conservés dans la photothèque de la Bibliothèque orientale présentée par Lévon Nordiguian. Enfin, il est aussi question « d’ailleurs » dans les images emblématiques du centre-ville de Beyrouth en ruine et réalisées dans le cadre de la mission photographique initiée par l’historienne et écrivaine Dominique Éddé. C’est d’ailleurs le témoignage de cette dernière qui introduit les clichés pris juste à la fin de la guerre civile par Gabriele Basilico, Joseph Kudelka, Robert Frank, Raymond Depardon, René Bourri et Fouad Elkhoury (Beyrouth centre-ville, 1991).
Du reste, les photographies des guerres libanaises ne pouvaient pas être absentes de ce parcours. Elles reviennent aussi comme souvenirs dans les conversations de Clémence Cottard Hachem avec les photoreporteurs Aline Manoukian et Patrick Baz, parmi les premiers à couvrir la guerre du Liban, mais elles sont toujours accompagnées d’une série de précisions sur la technique photographique. Comment jongler avec les contraintes imposées par l’urgence ? Pas possible, rappelle Patrick Baz, « de penser au temps d’exposition ou à la focale ». Quelles solutions trouver pour photographier les voitures piégées, malgré la fumée noire ? (Attentat à la voiture piégée, Ain el Remmaneh, Patrick Baz, 12 avril 1987). Où aller pour développer les pellicules et comment fonctionne le bélinographe ? La transmission des pellicules aux agences de presse à l’étranger était en effet une question fondamentale qui entraînait parfois le risque de la perte. Perte des images confiées aux passagers en voyage vers l’Europe et jamais arrivées à destination. Sur le plan de la représentation, les questions du danger lié à l’esthétisation des ruines et du rapport visuel à la violence sont bien sûr abordées par les textes. Les réponses les plus significatives, on les trouve par exemple dans ce cliché de Georges Semerjian, devenu symbole de l’absurdité du conflit – avec ce cheval échappé de l’hippodrome à la suite d’un bombardement qui se promène dans l’aéroport désert de Beyrouth (1980) –, ou encore dans les propos d’Oliver Rohe qui, parmi des images de guerre, et donc de l’anéantissement, « continue de chercher la création des formes ». Celles-ci apparaissent dans la silhouette d’une petite fille photographiée de dos qui joue au flipper au milieu des débris (Enfant jouant au flipper après un bombardement, Steve McCurry, 1982), ou encore dans les gestes quotidiens d’un barbier, le fauteuil et les miroirs installés dans la rue pour les clients de passage (Le coiffeur, Fouad Elkoury, 1982).
En passant des clichés photo-journalistiques, qui pendant plusieurs années ont été le visage public du Liban, à ceux plus intimes proposés par la plus récente génération de photographes, on reste désorienté, comme si en tournant la page on passait d’un lieu bruyant à une pièce silencieuse. Un silence tantôt lié à l’absence, au vide, qui repose entre les couvertures du lit de Nadim Asfar (Constellation, 2008) et les taies d’oreillers photographiées par Gilbert Hage (série Ana, Berthe, Emmanuelle, Huguette, Ingrid, Idriss, Julia, Louise, Margot, Marianne et Yara, 2007), tantôt à la solitude, comme dans les clichés muets de Tania Traboulsi (Seules, 2012). Les lignes de Gregory Buchakjian nous orientent dans la lecture de ces variations de l’intime et du corps. Que ce dernier soit mis en scène dans l’espace clos de la maison, ou exposé de manière provocatrice dans l’espace public, ces images révèlent toujours un questionnement sur l’identité, qui, tout comme la ville, s’avère constamment en voie de reconstruction.
Un autre aspect important de la photographie libanaise contemporaine réside dans l’usage de la matière photographique. À l’instar d’un traversier, ces modifications de la pellicule déplacent la photographie de la représentation des ruines au devenir ruine. Brûlée, grattée, enfouie, mais aussi retrouvée, archivée et racontée, la photographie se fait trace de ceux qui sont passés et de ce qui s’est passé. C’est le cas des clichés du Studio Mario retrouvés dans l’immeuble Barakat – aujourd’hui Beit Beirut – et devenus ensuite les images de Vartan Avakian (Suspended Silver, 2015), des monochromes de Walid Raad (Secret in the open sea, 1994/2004), des cartes postales brûlées de Hadjithomas et Joreige (Wonder Beirut. 1re partie : histoire d’un photographe pyromane, processus historique 1997–2006) ou encore du cliché surréaliste de François Sarlongo (Beyrouth Empire, scène 1, 2016), assemblage numérique à partir d’archives sur plaque corrodée à l’acide.
Serions-nous donc destinés à rester pris dans ce « cercle de confusion » où le corps de la ville en ruine, les corps des images et les images des corps ne semblent que devenir un dans un jeu de miroirs ? La photographie au Liban, affirme avec force cet ouvrage « poly- focal », est aussi tant d’autres choses. Elle est le lien ténu lors de l’expérience de l’émigration affirmé par la collection touchante d’Houda Kassatly ; elle est le regard moderne et irrévérencieux de la photographe Marie el Khazen (1899–1983) raconté par Fouad Elkoury, le même regard que cette femme au cheval qu’elle photographie et superpose à celui du Cheikh Khazen el Khazen (frère de la photographe) ; elle est la passion des collectionneurs comme Mohsen Yammine qui essaie de sauvegarder le patrimoine photographique du Liban-Nord de la disparition. Elle est enfin le travail remarquable de collecte, de conservation et de numérisation mené par la Fondation arabe pour l’image, jeu de mémoire et pilier de ce retour sur la photographie dans la région, mais qui peine à trouver des financements stables. Mais elle est surtout, affirme Ghassan Salhab, résilience. Car « le négatif sait que sans lui le monde est perdu, et il se dit qu’il n’est pas encore temps ».
Postdoctorante et chargée de cours au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal, Claudia Polledri assure aussi la coordination scientifique du CRIalt (Centre de recherches intermédiales sur les arts, les lettres et les techniques, UdeM). Elle est titulaire d’un doctorat en littérature comparée de l’Université de Montréal portant sur les représentations photographiques de Beyrouth (1982–2011) et sur le rapport entre photographie et histoire.
[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 111 – L’ESPACE DE LA COULEUR ]
[ Article individuel, en numérique, disponible ici : Clémence Cottard Hachem et Nour Salamé (dir.), Sur la photographie au Liban — Claudia Polledri ]