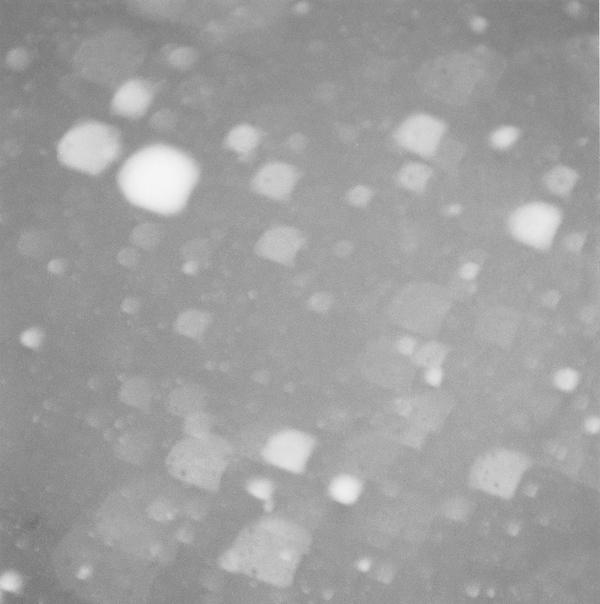[Hiver 1998-1999]
par Jennifer Couëlle
La représentation du quotidien dans la photographie d’art n’a jamais eu comme fin le simple témoignage du train-train journalier. Du moins pas dans sa substance, dans son insipide ordinaire. L’image photographique, après tout, n’est pas qu’indicielle. Elle est aussi, et surtout, représentation d’un réel dont elle détermine le relief.
Depuis la série des petits métiers en voie de disparition d’Eugène Atget aux dimanches après-midi à se souvenir entre nous de Raymonde April, en passant par les fermes fanées de l’Alabama post-1929 de Walker Evans, le surréel élégant des célèbres « instants » de Cartier-Bresson, les portraits glaçants de la middle class monstrueuse de Diane Arbus, les désordres d’une génération libre de tout de Nan Goldin, le cru bermudas bariolés de la sociologie de Martin Parr… chez tout un chacun, donc, la réalité est livrée à plus qu’elle-même. Elle n’est pas transposée, mais accusée : cataloguée (Atget), mythifiée (April, Goldin), à distance déplorée (Evans), singularisée (Cartier-Bresson), pointée (Arbus, Parr).
Sans être un motif aporétique de la photographie, le quotidien n’y apparaît jamais en tant que tel ; c’est son espace symbolique que représente l’image photographique. Et cela vaut également pour ces représentations où la vie de tous les jours se présente sans fard et participe, comme chez Arnaud Claass et Bernard Plossu, par exemple, d’une esthétique d’aléas ou de petits riens. Comme eux, Yan Giguère marche vers la vie sans attendre qu’elle fasse événement. Tour à tour, il l’a surprend, l’épie, l’expérimente et la laisse venir à lui. Du lundi au dimanche, elle est son support. Quant au sujet, il est une quête continue… d’un quotidien transcendé, écrit en vers, pas en prose. D’un quotidien non pas raconté, mais éprouvé. D’un quotidien qu’il peut au loin libérer, dans l’équivoque d’un inconscient collectif, précisément parce qu’il est sien, si familier que de l’anecdote il peut se passer.
Moins laconique et formelle que la photographie de Claass, plus près de l’indéterminisme de celle de Plossu (avec laquelle il partage une technique directe, des prises profuses et une genèse cheap camera, Instamatic et autres), l’œuvre de Giguère est poésie. Sa construction est stellaire. Son sens est ailleurs. Par-delà le descriptif des motifs, il s’inscrit dans les résonances qui s’opèrent entre différentes images, dans leur somme comme dans leur trajet. Car le plus souvent, cet artiste signe des œuvres multiples, constituées à partir d’un bassin hétérogène de photographies de son cru propre. Une réserve dont le contenu est en noir et blanc et en couleur. Intemporel, il remonte à hier ou à quelque dix ans auparavant ; indifférent, il est saisi par une kyrielle d’appareils, tantôt bas de gamme tantôt professionnels. Les vingt images en un certain ordre assemblées pour Au pied du courant (1996), la centaine pour Ici et là (1997), les douze pour le ci-reproduit Portrait de la lune en camion (1998) doivent leur présence « intra-œuvre » à un processus de sélection d’abord affectif, puis, au moment de disposer les images, la considération devient symbolique ; il est dès lors question des liens associatifs possibles entre chacune des épreuves.
C’est dire que l’œuvre devient la rencontre quasi fortuite de lieux et temps indépendants. Réconciliées, les distances ne sont pas pour autant dirigées. Si peu. Le contrôle ne se manifeste ici que faiblement; il est à peine plus que le geste du photographe et l’articulation matérielle de son image. Car poétique dans sa construction, la photographie de Giguère est d’une singulière légèreté dans ce qu’elle donne à regarder. Elle est à la fois profondément présente et infiniment détachée. Peut-être est-elle un pendant visuel de l’apport, surtout théorique, d’un Minor White qui voulut que « faire une photo [soit] d’abord faire le vide en soi-même, se mettre dans un état extrême de réceptivité. [Et qui conçut] quatre raisons de photographier : posséder le réel, pour le métamorphoser, mais pour apprendre à l’accepter, et surtout pour prendre conscience de la présence de la divinité en soi. »1 De correspondance en analogie, à propos de la production de ce précurseur de la poésie en images, l’historien Jean-Claude Lemagny écrit : « L’espace et le temps de mystère qui subsistent entre [chacune des photographies] conduisent le regardant à participer à l’œuvre par l’esprit. De leurs tensions naissent des rapports symboliques. »2 L’observation, bien entendu, sied aussi à la structure des ensembles photographiques de Giguère.
Et le lien se dissout. White fut un mystique avoué, volontaire surtout. Ses gros plans matiéristes de surfaces incertaines trahissent le poids d’une charge symbolique appuyée. Giguère, de son côté, tempère la composante « spiritualité ». Celle-là même qu’il cultive… Tout simplement, il la rend praticable. Le titre de l’œuvre présentée en ces pages (Portrait de la lune en camion) est d’ailleurs emblématique de la démarche holiste de cet artiste qui, sur un même plan, unit des clichés d’une amie dans le métro, d’autres d’objets traînant dans une cour arrière et des métaphores potentielles d’un céleste universel. Qui dans une même image fait se rencontrer la matérialité d’une cage d’escalier surmontée d’un puits de lumière et son expression transcendée : une voûte lumineuse, nimbée d’un flou circulaire, sorte d’aura organique née du geste du photographe qui, sous le puits, appareil à l’œil, a pivoté.
Un doigt de pierre qui pointe le firmament, tandis que résiste le lichen qui s’y acharne. L’ombre d’une main au-dessus d’une flaque d’eau troublée de cercles concentriques créés par le caillou qui vient à peine d’y être jeté. Une table de pique-nique mouchetée d’ombre et de soleil, exhalant à travers une tasse, un verre, des présences humaines, leur passage plutôt. Des herbes marines sous la coque d’un bateau en cale sèche qui joue les horizons la nuit. Des gens tranquillement affairés dans un champ. Des flocons de neige tombant hors foyer du ciel. Cela et encore, encore d’autres représentations de mains, d’autres contrastes aussi entre le clair et l’obscur, constituent une lecture (forcément impressionniste) du Portrait de la lune en camion. Portrait également d’une vie pleine de grâce espérée, de regards éthérés, où l’homme ne saurait pourtant se nier. Si les motifs de Giguère s’élèvent, par le truchement de sa vision, au-delà de leur a priori ordinaire, au-delà de nous, ils ne s’élèvent guère. Même voilé d’un bougé brumeux, même inconnu, un quelconque chemin enneigé porteur d’une bouche d’égout à peine lisible demeure simple, voire familier, si ce n’est sympathique, dans l’expression de son ailleurs mystique. S’il est vrai que nous participons à l’œuvre en réconciliant, d’instinct, ses différents espaces-temps, il semble également que nous accédons à ce désir d’union entre les choses, les êtres et l’univers. Entre un chemin, l’hiver, et son issue.
Non seulement la recherche de continuité spirituelle se fait-elle sentir plus que jamais dans la production de Giguère – dont les petites scènes tirées du déroulement de la vie témoignent si peu de son récit et tant et plus de son mystère –, mais elle a une orientation. Celle qui n’entend rien au schisme corps-esprit. Celle qui volontiers perçoit la chair comme « une pente dans l’âme qui résiste juste assez à l’attraction de Dieu pour m’assurer une existence propre. »3. Car la chair, « par sa distance [d’avec Dieu], elle produit l’espace ; par son hésitation, elle donne le temps. [Elle] est la courbure du regard qui rend possible la conscience. »4. La perspective conciliatrice de Maître Eckhart éclaire peut-être ce détachement tout en douceur des choses de la vie quotidienne que la photographie de Yan Giguère vient pourtant reconnaître dans son effleurement.
1 Jean-Claude Lemagny, « La Photographie inquiète d’elle-même (1950-1980) », Histoire de la photographie, sous la direction de Jean-Claude Lemagny et André Rouillé, Paris, Bordas, 1986, p. 192.
2 Ibid.
3 Jean Bédard, Maître Eckhart, Paris, Éditions Stock, 1998, p. 81.
4. Ibid.
Après avoir obtenu un D.E.C. en photographie au CÉGEP du Vieux Montréal, l’artiste montréalais Yan Giguère a poursuivi des études en photographie à l’Université Concordia de 1995 à 1996. En 1995, il présenta une exposition solo remarquée à la Galerie Clark (Montréal). Depuis, il a participé à plusieurs expositions de groupe dont Artifice 96 (Montréal), Tout un chacun (Galerie VU, Québec) Ode au Quotidien (Galerie Vox, Montréal et Galerie Séquence, Chicoutimi) et Antidote : la légèreté à l’œuvre (Galerie Plein-Sud, Longueuil).
Jennifer Couëlle vit et travaille à Montréal. Critique d’art, journaliste et commissaire d’exposition, elle publie régulièrement des écrits sur l’art depuis 1989. On peut la lire entre autre dans les revues Parachute, CVphoto, Canadian Art et Art Press.