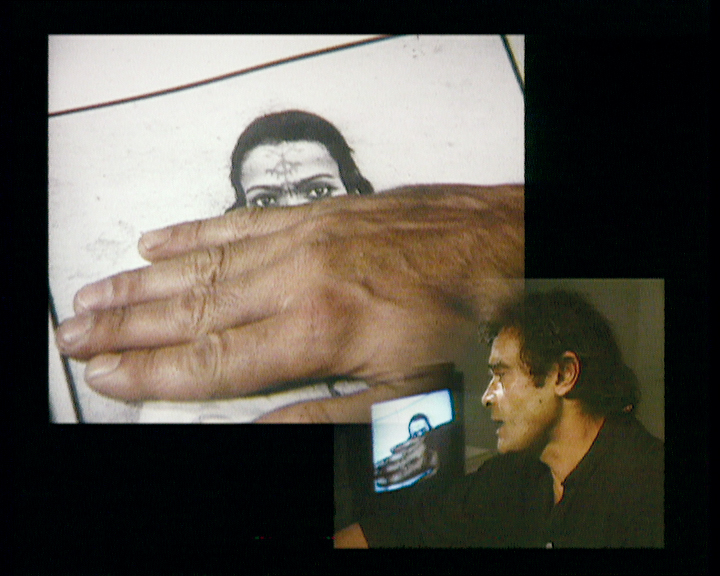[Printemps 2008]
L’installation vidéo Deep Play dont il est question ici sera présentée à Montréal du 21 février au 25 mai 2008 à la DHC/ART Foundation for Contemporary Art.
Deep Play consiste en une documentation en temps réel du match final de la Coupe du monde de football 2006 entre la France et l’Italie. Harun Farocki a récolté des artefacts visuels produits lors du match au moyen de différents dispositifs d’analyse et de captation d’images. À l’image optique que connaissent les téléspectateurs de l’événement, se superposent et se juxtaposent des images schématiques qui permettent aux différentes institutions et industries culturelles de rationaliser et de gérer l’exploitation d’un tel événement: séquences numériques qui analysent le mouvement des joueurs, statistiques comptabilisant les différentes actions sur le terrain de jeu, images des caméras de surveillance, etc.
par André Habib et Pavel Pavlov
Pavel Pavlov : Vos films exposent diverses institutions: le monde carcéral, militaire, celui de la publicité ou, comme dans l’installation Deep Play, le monde de la télévision et du football. Quelle est la nature de vos échanges avec elles ?
Harun Farocki : On ne peut pas vraiment parler d’un échange. Une institution comme la FIFA est très bureaucratique, elle détient un monopole et n’a pas besoin de se faire aimer. C’était différent pour les compagnies ou les centres de recherche qui développaient des logiciels de traitement de l’information ou de l’image, dans la mesure où ils tentaient de les promouvoir ou encore de les vendre. Je connais une femme qui a rédigé une thèse sur la possibilité de transformer une image en texte. Pour elle, le soccer est un bon exemple à prendre, parce qu’il y a somme toute peu de règles. À partir du moment où vous avez un joueur qui se déplace sur le terrain, il est possible de définir son action: il a passé le ballon, il a marqué un but, etc. Il est assez simple de fixer ses coordonnées. Cette femme ne s’intéresse pas au football en soi, seulement parce que c’est un bon exemple d’un système réduit. Je m’intéresse au football un peu pour les mêmes raisons. En même temps, il y a peu d’événements qui attirent autant de caméras. Tant d’intelligence humaine pointée sur une surface de quelques centaines de mètres carrés de gazon ! Ces industries font finalement avec le soccer ce qu’ils ont fait avec les usines, les champs de bataille.
PP : Deep Play expose le rôle de différentes industries dans l’organisation et l’exploitation d’un tel événement médiatique. Comment avez-vous conçu cette installation qui occupait une place centrale à la Documenta ?
HF : Tout d’abord, l’idée venait du commissaire Roger Buergel. C’est lui qui a commandé l’œuvre et qui a trouvé les fonds nécessaires pour la financer. Il ne m’avait pas averti qu’elle serait présentée dans cette rotonde [du Museum Fridericianum], je ne l’ai su que bien plus tard. Au début, nous voulions la projeter sur des écrans de projection, mais au final nous avons opté pour ces écrans plats parce qu’il n’y avait pas d’espace, peu de lumière. À Oslo, récemment, l’œuvre a pu être exposée selon mon vœu initial, sur 12 écrans de projection [Musée d’art contemporain d’Oslo, 13 oct. 2007 – 6 janv. 2008]. Je crois que c’est mieux ainsi, dans la mesure où il n’y a pas cette question de hiérarchie. Les références croisées entre les images ne parviennent pas à se faire si tous les écrans sont comprimés dans un espace étroit. Si vous reculez, vous devriez voir les douze images, alors qu’à la Documenta il n’était possible d’en voir que trois ou quatre.
PP : Revenons à votre rapport avec les institutions. Comment les gens qui les représentent voient-ils votre travail ?
HF : Il y a 30 ans, les gens croyaient que la télévision allait exercer une grande influence. Aussi, ils s’habillaient bien, essayaient de dire des choses profondes et me demandaient de filmer cette machine plutôt que telle autre, parce qu’elle était plus neuve, etc. Maintenant, l’atmosphère est plus détendue. Ils ont appris entre-temps que ces détails n’auront aucun impact, et ils vous laissent filmer. Avant, je pouvais encore raconter des histoires : «Je travaille pour la télévision, et nous préparons une série (bien normale) sur les usines». Aujourd’hui, ils consultent tout de suite Internet et ils parviennent à savoir plus ou moins qui je suis, ce que j’ai fait. En 2000, quand j’ai commencé un projet sur les armes et l’industrie militaire, on s’intéressait assez peu à la guerre, donc c’était plus facile d’obtenir du matériel. Puis, le 11 septembre est survenu et il est devenu très difficile d’accéder à certaines archives aux États-Unis. Mais en même temps, l’industrie militaire est devenue soucieuse de son image, et elle cherche à faire la promotion de sa technologie, donc il a été à nouveau possible d’accéder à certaines choses. En général, il y a beaucoup moins de bureaucratie qu’il y a 30 ans, ce qui facilite les choses.
Par exemple, il est assez frappant de constater que les gens qui travaillent dans l’industrie militaire sont extrêmement intelligents. Il est possible d’avoir avec eux des discussions très sérieuses sur des questions stratégiques, des questions d’éthique. Ce ne sont pas que des «têtes brûlées» (war heads). Ils savent ce qu’ils font. C’est assez surprenant. Ainsi, il y avait un type qui était bien content de quitter ce boulot, parce qu’il avait décroché un poste comme enseignant. Ou une responsable des relations publiques qui était ravie de voir que quelqu’un avait réalisé quelque chose qui, d’un point de vue esthétique, était rattaché au travail qu’ils faisaient, et non un reportage traditionnel. Ce sont des rencontres assez bizarres…
André Habib : Plusieurs cinéastes (Akerman, Kiarostami, Varda) semblent avoir trouvé au musée un espace de liberté dont ils sont privés aujourd’hui dans le monde du cinéma. Dans la mesure où certaines de vos œuvres existent à la fois comme film et comme installation, êtes-vous appelé à penser aux deux formes lorsque vous vous lancez dans un projet ?
HF : Si on prend l’exemple de Œil/Machine, c’était pratique de pouvoir réaliser quelques installations parallèlement à la réalisation des films. C’est comme lorsque l’on écrit un livre et que l’on publie des articles en utilisant le même matériel de recherche. En général, par contre, j’essaie, même si j’expose dans un musée, d’être un documentariste, et non un artiste visuel.
AH : Plusieurs de vos films, même avant que vous commenciez à réaliser des installations, semblaient posséder un «potentiel d’installation». Vous tâchez souvent de penser les images dans leur simultanéité, non comme une chaîne d’images qui s’annulent. Par exemple, votre film Images du monde et inscription de la guerre pourrait être montré sur de multiples écrans ou canaux. Diriez-vous que la spatialisation de votre travail dans l’espace de la galerie était déjà présente dans vos films ?
HF : Oui, vous avez raison. Quand j’ai vu D’est de Chantal Akerman, j’ai compris comment il était possible d’isoler certains éléments d’un film et d’en faire une installation. Cela a en effet à voir avec une certaine façon de construire les choses. On peut aussi dire que le caractère de la boucle a toujours été présent dans mon travail. Déjà, dans l’un de mes premiers films, Feu inextinguible, on retrouve cette structure en boucle, où des choses reviennent. Je crois que j’ai été influencé par Brecht, mais sur ce point précis, par Beckett, qui était très influent à l’époque.
PP : Plusieurs de vos films font appel à la pensée marxiste, d’autres évoquent des théories sémiotiques. Aujourd’hui, avez-vous un modèle théorique avec lequel vous travaillez ?
HF : En 1968, quand je travaillais sur Feu inextinguible, j’avais surtout lu Marx, et très peu Christian Metz ou Umberto Eco. Ce fut plus tard. De la même façon, ce n’est que plus tard que nous avons découvert Benveniste en Allemagne, l’histoire de la sémiotique, les théories sur le signe. Bien sûr, j’ai été influencé par Foucault, par Virilio aussi. Même si je ne partage pas certaines de leurs idées, ils sont très inspirants. Ce qu’il a dit à propos des missiles, durant la guerre du Golfe, était très juste. Mais on ne peut pas dire que j’ai un modèle théorique. Je crois que les gens qui travaillent sur les médias ont tendance à exagérer, et à penser que tout est média. Je ne suis pas de cet avis. Je crois que la production matérielle a son importance, même si elle tend à devenir de plus en plus immatérielle. Je crois aussi que les contradictions entre les superstructures idéologiques et les modes de production ne sont pas véritablement considérées aujourd’hui.
AH : En même temps, il ne semble pas que vous manquiez d’interlocuteurs aujourd’hui. Vous avez lancé il y a quelques années ce projet, avec Friedrich Kittler et Wolfgang Ernst, d’un lexique des expressions cinématographiques; vous avez co-écrit un livre avec Kaja Silverman sur Godard [Speaking about Godard]. Alors que Godard de son côté semble de plus en plus dans une position solitaire, isolée, vous ne semblez pas éprouver une solitude comme la sienne.
HF : Non, en effet. J’ai des amis, des collaborateurs. J’ai mis sur pied un cercle de lecture, comme lorsque j’avais vingt ans. Depuis deux ans nous avons lu Agamben et Rancière, en groupe. Il s’agit de jeunes professeurs, de gens qui travaillent dans le monde de la culture. De plus, mon poste d’enseignant à Vienne me permet de rencontrer des gens très intéressants. Je ne sens pas que je manque d’échanges. En même temps, je me dis que nous ne connaissons rien du monde actuel. Nous devrions tenir des salons où il serait possible de rencontrer des chimistes, des physiciens, mais cela ne semble jamais pouvoir se réaliser. Heureusement, grâce à mes documentaires, je suis amené à explorer plusieurs milieux, ce qui me permet d’apprendre un peu plus sur les ordinateurs, l’industrie de la guerre, les designers de galeries commerciales. Cela fait partie de la réalité sociale. Je pars souvent en voyage de recherche avec des grandes compagnies. Je visite plus de compagnies que de musées. C’est une chance…
AH : Vous devriez amener Godard avec vous, comme ça…
HF : Une bonne idée. Il se sentirait peut-être moins seul !
Cet entretien a été réalisé lors de l’exposition de Harun Farocki One Image Doesn’t Take the Place of the Previous One, à la galerie Leonard & Bina Ellen de l’Université Concordia à Montréal.
On trouvera la version intégrale de cet entretien sur le site de la revue Hors champ (www.horschamp.qc.ca).
André Habib termine une thèse de doctorat en littérature comparée à l’Université de Montréal portant sur l’imaginaire des ruines au cinéma. Il a été chargé de cours dans les quatre universités de Montréal et est coéditeur de la revue électronique Hors champ. Il a collaboré à un ouvrage collectif sur Chris Marker qui paraîtra à L’Harmattan en 2008.
Pavel Pavlov est artiste. Il prépare une thèse de doctorat sur la photographie conceptuelle de plein air dans les années 1960-1970.