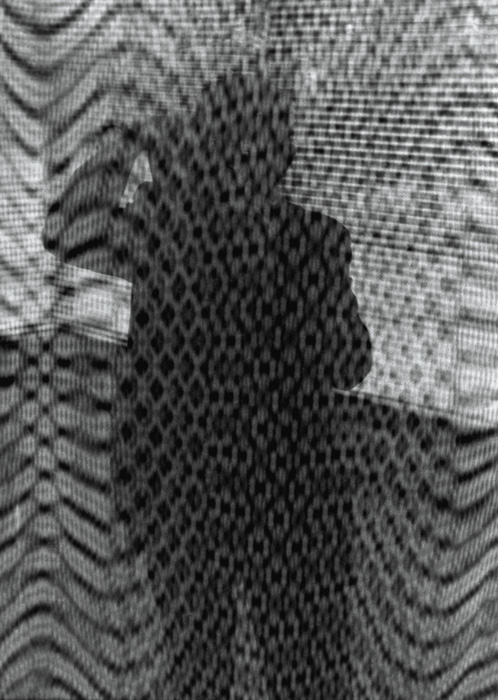Par Zoë Tousignant
Béla Ferenc Egyedi est né en 1913 à Esztergom, en Hongrie. Il a immigré au Canada en 1951 et vécu de nombreuses années dans le quartier montréalais de Milton-Parc, à diverses adresses de l’avenue Lorne et de la rue Durocher, près de la rue Milton. Il était à la fois photographe, graveur, poète et céramiste. Il est mort intestat en 1982, à l’âge de soixante-six ans. Puisqu’il n’avait pas de famille au Canada, toutes ses possessions – y compris ses nombreuses œuvres – furent saisies par le Curateur public du Québec et vendues aux enchères. Le Musée McCord acquit sa collection de photographies, qui en compte plusieurs milliers.
J’ai découvert ce fonds au printemps 2013, et j’ai été immédiatement intriguée et charmée (il n’y a pas d’autre mot) par la figure qui en émergeait, l’homme lui-même1. Le fonds comprend quelques dizaines de tirages d’exposition grand format, dix-sept maquettes d’exposition montées sur carton, deux classeurs contenant des tirages et des négatifs, et sept boîtes d’archives au format lettre, remplies à ras bord de photographies de petite taille et de taille moyenne. Un élément distinguait notamment ce fonds des autres que j’ai consultés ce jour-là : le nombre remarquable, presque excessif, d’autoportraits.
Au fur et à mesure que je passais en revue les sept boîtes d’archives, qui contiennent quelques agrandissements faits par Egyedi lui-même ainsi que des centaines de petits tirages réalisés par des laboratoires montréalais, l’aspect récurrent de l’autoportrait dans son œuvre s’est imposé clairement. En dehors d’une unique photo de jeunesse qui le montre en 1933, fraîchement diplômé, les portraits d’Egyedi semblent s’échelonner de l’après-guerre jusqu’à la fin de sa vie. Ils sont souvent pris chez lui, où il pose à côté d’un ensemble d’objets personnels, mais la majorité le représentent à l’extérieur, généralement dans un paysage. En dehors d’une ou deux exceptions, il est représenté seul.
La répétition même de son image dans une foule de contextes et de poses – regardant souvent droit dans l’objectif – donne l’impression que, chez Egyedi, l’autoportrait était une forme d’expression pratiquée de façon un peu maniaque, mais également exploitée pour son potentiel performatif considérable. Seule une petite part du nombre total de portraits a fait l’objet d’un agrandissement (dont certains sont reproduits ici), mais il est évident que l’autoportrait était pour lui un outil d’auto-affirmation, une manière de dire « je suis ici ». Toujours avec une touche d’humour pince-sans-rire et, ajouterai-je, un très bel usage des ombres denses, le photographe semble avoir enregistré sa propre image pour se tailler symboliquement une place dans son pays d’adoption.
Pourquoi fait-on des autoportraits ? Que signifient-ils ? Souvent perçus comme des symboles de narcissisme inquiétants, ils signifient fondamentalement que nous sommes seuls : nous réalisons un autoportrait parce que personne n’est là pour nous prendre en photo. Ils nous permettent également d’exercer un plus grand contrôle sur notre image : plutôt que d’être à la merci d’un autre regard, nous pouvons nous présenter au monde extérieur d’une manière qui satisfasse à notre perception de nous-mêmes. Et ils peuvent être de bons outils d’auto-analyse : observer son image dans diverses poses, attitudes et cadres à différents moments peut tout simplement aider à mieux se connaître.
L’autoportrait est depuis longtemps un genre important dans l’histoire de la culture visuelle, et encore plus dans l’histoire de la photographie, où les plus anciens exemples connus, un trio d’images réalisées par Hippolyte Bayard en 1840 – Le noyé (Autoportrait en noyé) – constituent de captivants modèles d’autofiction2. Le xxe siècle a vu naître des photographes influents dans le domaine de l’autoportrait, dont Claude Cahun, Andy Warhol et Cindy Sherman, qui ont tous pleinement tiré parti de sa dimension performative. L’autoportrait n’est donc pas récent, mais il est de toute évidence plus en vogue que jamais. nous sommes à « l’ère de l’égoportrait » : l’imagerie narcissique s’est normalisée en inondant toutes les avenues disponibles des médias sociaux, voire en infiltrant – même de façon consciente – les médias plus traditionnels : livres, journaux et télévision3. L’égoportrait (le selfie, en anglais) n’est plus l’apanage exclusif des adolescents de quatorze ans ; il prend aujourd’hui une place importante dans l’économie contemporaine de l’imagerie photographique.
Il ne fait pas de doute que l’importance actuelle du genre est ce qui motive et justifie mon intérêt pour les autoportraits d’Egyedi. Ses images présentent une familiarité séduisante, un caractère contemporain d’autant plus fascinant que les plus anciennes d’entre elles remontent à plus de soixante ans.
Leur caractère familier vient également de leur proximité avec un autre développement de la photographie contemporaine : le phénomène Vivian Maier. Vers 2010, l’univers de la photographie a été pris d’assaut par la découverte d’un impressionnant corpus, l’œuvre d’une mystérieuse inconnue – « la gouvernante qui prenait des photos ». Maier, qui est morte dans une relative obscurité et pauvreté en 2009, a pratiqué la photographie avec assiduité durant plusieurs décennies, tout en travaillant comme gouvernante pour des familles aisées vivant essentiellement dans la région de Chicago. Sans jamais tenter de vendre ni de diffuser ses photographies, elle a néanmoins créé un témoignage particulièrement riche de la vie urbaine aux États-Unis, des années 1950 aux années 1990. Ses archives personnelles, comprenant des milliers de négatifs et de rouleaux de films non développés, ont été achetées aux enchères deux ans avant sa mort par une poignée de collectionneurs, qui se sont donné la mission de faire connaître son travail sur la scène internationale. Depuis 2010, plusieurs livres, des dizaines d’expositions et deux documentaires lui ont été consacrés.
Maier était indubitablement une photographe douée, mais son succès posthume semble dû en partie au mystère entourant sa vie et à l’ambiguïté de ses motivations photographiques – du moins selon les deux documentaires qui ont été réalisés sur elle, et qui adoptent des approches différentes pour combler ces lacunes. Celle choisie dans Finding Vivian Maier (2013), un film écrit, réalisé et produit par Charlie Siskel et John Maloof (ce dernier étant l’un des principaux propriétaires de son œuvre), consiste à interviewer diverses personnes qui ont côtoyé Maier, y compris certains enfants dont elle s’occupait. Ces points de vue sur la photographe étant nécessairement limités et se contredisant souvent entre eux, le mystère qui l’entoure est ainsi laissé intact, voire cultivé, par le film. Vivian Maier: Who Took Nanny’s Pictures (2013), le film réalisé par Jill nicholls et produit par la BBC, utilise une approche plus archivistique, en essayant de recomposer le casse-tête à l’aide de documents publics, de lettres personnelles et de certaines photographies.
L’aspect controversé – et intéressant d’un point de vue théorique – du phénomène Vivian Maier réside dans le fait que la grande majorité des tirages qui ont été vendus et diffusés dans le circuit international des galeries ont été réalisés après sa mort, à partir de négatifs. Son corpus, qui compte plus de 150 000 images, a subi un processus de sélection considérable de la part de ses propriétaires actuels, et c’est sur la base de ce processus que ses photographies sont reconnues aujourd’hui. Joel Meyerowitz, qui est interviewé en tant que spécialiste de la photographie de rue dans les deux documentaires, résume cette controverse dans le film de la BBC lorsqu’il demande d’un air préoccupé : « Sur quoi se basent-ils pour faire leur sélection ? » Autrement dit, puisqu’on sait si peu de chose sur l’intention de Maier en tant que productrice d’images, qui sont-ils pour déterminer la nature de son héritage photographique ?
Tout comme Egyedi, Maier était une adepte de l’autoportrait. L’un des livres publiés sur elle (et conçu par Maloof) est dédié à ses autoportraits. Comme ceux d’Egyedi, ils sont fascinants, notamment parce qu’ils incarnent un paradoxe qui est au cœur du phénomène Vivian Maier : elle y est simultanément présente et absente. Maier fut, jusqu’à sa mort, totalement absente de l’histoire de la photographie, mais le support concret de ses propres photographies lui offre une présence fantômatique et récurrente. À ce jour, Egyedi a, lui aussi, été totalement absent de l’histoire de la photographie – même à l’échelle locale. Pourtant, dans ses archives, il est omniprésent.
En examinant ses photographies et d’autres documents du fonds, on parvient à rassembler quelques informations sur la vie et l’art de Béla Egyedi. La collection McCord contient quelques-unes des affiches d’exposition qu’il a conçues et gravées lui-même. Celles-ci révèlent, par exemple, qu’il a exposé son travail à divers endroits à Montréal dans les années 1970 et 1980, dont Véhicule Art et la librairie Paragraph – et qu’il admirait son compatriote, le photographe André Kertész, auquel il a dédié une exposition (intitulée Humor Foto). Le fonds contient aussi certaines publications d’Egyedi, prouvant qu’il a régulièrement contribué par des œuvres graphiques et des poèmes aux journaux littéraires canadiens Nebula et The Antigonish Review. Parmi les publications figure un exemplaire de son livre à compte d’auteur Haiku etc., un ouvrage de poésie et de prose libre qui comprend une courte autobiographie.
Cette autobiographie fait émerger une image un peu plus nette des circonstances qui ont entouré les débuts d’Egyedi et son immigration au Canada. Selon ses propres termes, il était le « sixième enfant d’un peintre “pauvre-mais-honnête” (légende familiale : son rêve d’être un artiste, son “benjamin” l’a réalisé (en suivant les traces du rêve paternel, faute de mieux4) dans un pays où, avec la vocation de son père, il aurait connu le succè$)5 ». Avec un humour noir caractéristique et une verve incisive, il raconte qu’il avait à peine plus de six mois au début de la Première guerre mondiale, qui le privera de son père pendant toute sa durée. Sa mère meurt de la grippe espagnole en 1919, après quoi son père se remarie. En dépit d’une vie familiale difficile, Egyedi excellait à l’école, et il avait entamé des études universitaires en littérature et linguistique françaises et allemandes lorsque la Seconde guerre mondiale a éclaté, ce qui le conduira à acquérir une licence plus « pratique » en journalisme. Ayant travaillé pour l’Agence de presse hongroise, et donc exempté de service militaire, Egyedi est « libéré » par les troupes russes durant le siège de Budapest en 1944, puis interné comme prisonnier de guerre. En 1948, il s’enfuit de Hongrie et parvient à Paris, où il demeura jusqu’en 1951, avant d’immigrer au Canada avec le statut de réfugié. Établi principalement à Montréal, il effectuera plusieurs voyages dans l’ouest et le nord canadiens en tant que travailleur itinérant.
Après sa mort en 1982, un hommage d’une page à Egyedi a été publié dans The Antigonish Review. L’article déclare qu’il « n’a pas reçu la reconnaissance que ses talents auraient dû lui apporter… nos rapports avec Béla nous ont rendus plus conscients de la remarquable contribution apportée à la culture canadienne par les milliers d’immigrants qui ont fui le continent européen au cours des quarante-cinquante dernières années. Beaucoup d’entre eux ont connu le succès et la reconnaissance ici, dans divers domaines. De nombreux autres, ayant immigré dans la trentaine ou la quarantaine, n’ont pas eu cette chance : ils ont œuvré dans l’obscurité 6 ».
Reconnu pour sa contribution dans le domaine littéraire, il a également été salué en tant que « mail artist » par un site Web contemporain dédié à ce genre 7. on ignore en quoi consistait cet art postal, mais ses écrits personnels révèlent une véritable obsession autour de la réception du courrier. Frustré par le manque de fiabilité du service postal canadien, il s’est même doté d’une case postale en supplément. Par un coup du sort que son sens de l’humour singulier aurait sans doute apprécié, il est mort après avoir été heurté par une camionnette des postes.
Cependant, les archives photographiques d’Egyedi, acquises par le Musée McCord à peine quelques mois après sa mort, sont restées en dormance pendant plus de trente ans (les images reproduites ici ont été cataloguées et numérisées pour cet essai). or, il n’est pas seul. À vrai dire, il y a beaucoup de fonds similaires au Musée McCord – et dans des milliers d’autres collections photographiques à travers le monde. Que faire alors avec ces photographies ?
À mon avis, la réponse n’est pas d’essayer de faire entrer des cas comme celui d’Egyedi dans le cadre conventionnel de l’histoire de la photographie – en réimprimant un éventail savamment choisi de ses œuvres – pour essayer de le transformer en un « maître de la photographie » comme ce fut fait avec Vivian Maier. Car il y a une raison pour laquelle Egyedi ne rentrait pas dans ce cadre conventionnel au départ : il était différent.
L’attrait grandissant pour le vernaculaire dans le domaine des études photographiques a ouvert les portes à un tout nouveau domaine de production : instantanés, cartes de visite, cartes postales et autres traces éphémères sont aujourd’hui souvent étudiés par les historiens – et utilisés comme matériau par les artistes contemporains. Dans ce contexte, des photographes inconnus ou oubliés comme Egyedi et Maier continueront de sortir de l’ombre. C’est une bonne chose, mais ce processus doit également nous amener à renouveler notre perception du photographe. Egyedi est un cas intéressant parce qu’il avait une démarche que je qualifierais véritablement de pratique photographique. S’il ne se préoccupait visiblement pas de produire des tirages de qualité muséale en édition limitée, il utilisait incontestablement la photographie pour explorer les manifestations de sa propre subjectivité. Sans relâche, il nous confronte à cette subjectivité ; depuis les profondeurs des archives, il exige d’être enfin vu.
Traduit par Emmanuelle Bouet
2 Voir le point de vue de geoffrey Batchen sur les photographies de Bayard dans Burning with Desire: The Conception of Photography, Cambridge, Mass., MIT Press, 1997, p. 157-173.
3 La star de téléréalité Kim Kardashian publiera en 2015 Selfish, un ouvrage consacré à ses égoportraits, aux éditions Rizzoli ; The New York Times a publié le 29 décembre 2013 un article de l’acteur James Franco intitulé « The Meanings of the Selfie » ; l’émission télévisée Selfie, interprétation contemporaine du Pygmalion de George Bernard Shaw, est en ondes depuis septembre 2014.
4 En français dans le texte.
5 Béla F. Egyedi, Haiku etc., Montréal, l’auteur, 1980, p. 25. (notre traduction.)
6 George Sanderson, « Tribute to Béla Egyedi », The Antigonish Review, no 51 (automne 1982), p. 5.
7 « The Dead Mailartists Club », Mailbox Friends: Keith Bates’s Postal Art Site, en ligne : http://keithbates.co.uk/cameraderie.html, consulté le 26 septembre 2014.
Zoë Tousignant est historienne de la photographie et commissaire indépendante. Elle est titulaire d’une maîtrise en études muséales de l’University of Leeds et d’un doctorat en histoire de l’art de l’Université Concordia. Elle s’intéresse notamment à la dissémination de la culture photographique au Canada d’hier à aujourd’hui.