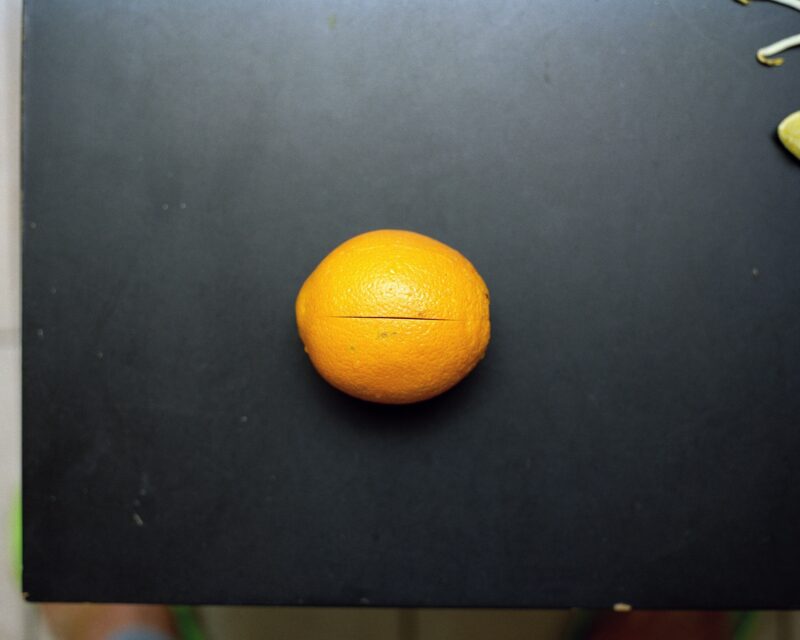[Été 2021]
Don d’images
par Sylvain Campeau
La pratique artistique de Chih-Chien Wang s’est d’abord caractérisée par un recours croisé aux médiums de la photographie et de la vidéographie. Aussi peut-il paraître incongru d’aborder son travail sous l’angle de la nature morte. Il n’en reste pas moins que des allusions à ce genre reviennent sans cesse, sans qu’elles n’aient jamais inspiré aux analystes et critiques à en faire plus que ça, justement, une allusion.
Assemblages du quotidien. À regarder les images, on est rapidement convaincu que cette référence n’est pas gratuite. Aliments, fruits, végétaux y occupent une grande place. Il arrive que la composition baigne dans un certain dépouillement ; les éléments sont isolés, au centre de l’image. On pense aux séries Cabbage Flower (2011), Pineapple (2011), Apple After Shaore (2014), aux images Sad et Happy de la série Orange (2014) et j’en passe. Ou aux ensembles complétés par des éléments domestiques: Grape and Tea Bag (2005), Banana in a Glass (2005), Watermelon, Coffee and Detergent (2009), White Cans and Pineapple (2009). Puis à des scènes plus complexes : Oranges, a Glass Ball and Shadows (2016), Pomegranates, Plastic Packaging and Wood (2016), Stems and Orange Peels on Cardboard (2020).
La nature morte. Selon Charles Sterling, spécialiste du genre, « Une authentique nature morte naît le jour où un peintre prend la décision fondamentale de choisir comme sujet et d’organiser en une entité plastique un groupe d’objets1 ». Ceux-ci correspondent souvent à la catégorie des aliments domestiques.
Il a fallu plusieurs variantes pour en venir à cette définition englobante, minimale : cose naturali (« choses naturelles ») chez Giorgio Vasari, à la fin du XVIIe siècle; stilleven, vers la même époque en Flandre, pour désigner des «pièces de fruits, fleurs, poissons» ou des «pièces de repas servis»; bodegón, du terme bodega (« lieu de rangement alimentaire »), utilisé pour décrire l’antichambre dans les caves de tavernes modestes en Espagne.
Ces représentations entretiennent des liens privilégiés avec une nourriture consommée et soulignent ou célèbrent la tenue de festins. Le terme grec xeniae, par ailleurs, désignait des mets délicats, friandises ou pâtisseries, que s’envoyaient entre eux des amis, durant les Saturnales particulièrement.
Anne Cauquelin aborde le sujet dans le livre L’invention du paysage. Elle précise d’abord que ces « cadeaux de table » sont « des présents “ en natures ”, corbeille de fruits, mets rares, pièces montées que l’on consommera en souvenir du dîner », histoire de pérenniser le moment ainsi remémoré, « qui se répétera le lendemain ». Ces présents étaient souvent accompagnés d’un tableau représentant l’envoi, offrant le « (r)edoublement de la chose en son icône ». La xeniae est rappel et commémoration d’un moment de rencontre et de bonne chère partagée, en plus d’être une invitation à répéter l’expérience, en solitaire, dans le souvenir heureux d’un événement passé.
Ce ne sont pas des repas ou des tables apprêtées que cherche à montrer Chih-Chien Wang. Chez lui, quand l’élément issu du monde végétal n’est pas sujet unique, il demeure central, accompagné par peu d’éléments et formant le point d’orgue (ou l’un d’eux) de la représentation.
Dans les œuvres de cet artiste, les aliments ne peuvent être considérés comme prêts à la consommation. Au gré des multiples œuvres qu’il a réalisées, on peut voir des ananas étrangement torsadés (série Pineapple), des choux bizarrement lacérés (série Cabbage Flower), une poire qui se noie (Pear and Glass Water, 2017), des bananes mutilées (Banana Flower #1, Banana in a Glass, 2005) et un reste de queue d’aubergine, racorni (Stalk of Eggplant on Bookshelf, 2009). Ils sont moins destinés à la consommation qu’aptes à évoquer le moment précédent, la préparation, ou le subséquent, sa mise au rebut (série Apple After Shaore). Ils sont en amont et en aval de toute consommation, encore plus que ne l’est la nature morte traditionnelle. Une fois transfiguré et ainsi posé parmi des objets familiers du quotidien, l’aliment acquiert une autre stature. Il se prête au jeu du sens, avant même d’être soumis à celui des sens.
Les œuvres vidéo. Les œuvres vidéographiques de Chih-Chien Wang évoquent à l’occasion la consommation. Time Measurement #3 #4 #5 (2008) présente un tableau en triple projection. À une des extrémités du triptyque, des bouts de haricots verts, équeutés, tombent un par un. À l’autre bout, ce sont des morceaux de fraises qui surgissent, derrière une surface translucide. Cette matière donne aussi prise au geste d’écrire une histoire en chinois. On la déchiffre à l’aide de sous-titres et on comprend peu à peu qu’il s’agit d’un rêve. Il y est question de languettes de calmars séchés, infestées de vers, tout de même comestibles. Retenons qu’il y est encore question d’aliments.
La thématique de la nourriture est donc assez présente dans les œuvres de l’artiste. Même dans ses vidéos, ce ne sont pas des tables montées, des plats préparés, qui en forment l’essentiel, mais des éléments isolés, pas encore transformés ni prêts à être absorbés. En fait, c’est tout le contraire : les aliments, sauf exception, sont encore à l’état brut, en instance de préparation, ou alors ils sont étrangement entamés. Ce ne sont pas des nourritures finies, complétées ; ce sont des éléments encore disparates, en cours d’élaboration, ou des résidus abandonnés après consommation incomplète. Ou alors, ils ont été altérés, de façon accidentelle ou volontaire, et leur forme ou disposition évoque autre chose avec excentricité.
La nature morte est partie prenante d’un don et ceci est encore plus évident dans le cas de Chih-Chien Wang. Car les aliments semblent souvent pris dans le cycle d’une confection. Plus encore que d’une consommation, il est question de la mise en place des conditions pour un partage. Ou des restes d’un repas, lors la prise de vue de victuailles oubliées, laissées avec le souvenir d’une bouchée. Nous sommes devant des images qui célèbrent soit le futur acte de manger, soit le fait de l’avoir fait. L’aliment préparé ou laissé pour compte sera, ou a été, l’occasion d’un partage.
Les évocations de la préparation d’un aliment mettent l’accent sur la réalité de le faire ensemble, proposent que le repas est marqué par l’effort et le travail, par la mise en commun de ressources, par la réunion de convives. Manger est une affaire collective ; se préparer au partage des aliments en est une de solidarité. Comme dans le rêve raconté dans Time Measurements #5 – Strawberry, liens interpersonnels et nourriture vont de pair.
Les expositions de Chih-Chien Wang ne se composent pas que d’images photographiques et d’œuvres vidéographiques. Des actions sont suggérées. En effet, il arrive que l’artiste tienne à ce que des spectateurs puissent participer plus activement à la rencontre. Dans le cas de When the Shadows Change Colour (2014), il y avait invitation à se saisir de petites images ou de feuilles séchées, à prendre et à laisser des objets. Dans le cas de The Act of Forgetting (2015), il fallait exécuter des actions décrites par l’artiste. Des éléments sont offerts. Des directives invitent à un échange. Le contexte d’exposition fournit à l’artiste l’occasion d’inciter les gens à agir, à se manifester, à prendre et à donner. À son offre correspond une contrepartie active. Il s’agit bien de partage, d’échange.
Les confessions : offrandes. La nature morte n’est pas pour l’artiste une référence isolée, puisque d’autres thèmes et des interventions dans l’espace d’exposition contribuent aussi à créer un esprit de don et d’échange.
Dans la vidéo I Want to Be Reminded (2014), au cœur de l’exposition When The Shadows Change Colour, il est question d’une conversation entre deux femmes. On comprend rapidement qu’il s’agit d’une construction et non de la saisie d’un moment réel d’intimité. Dans leur échange, les protagonistes font allusion à une lettre envoyée de l’une à l’autre et à ce qu’elle pouvait signifier alors, et aujourd’hui encore. Leur dialogue nous fait découvrir qu’un lien fort les unit, qu’elles forment un couple et qu’elles ont émigré de Taïwan. À la volonté de faire ressurgir le passé de l’une vient s’opposer le désir de l’autre de jouir du moment présent. L’œuvre évoque et examine ce que chacune est devenue après s’être établie dans un nouveau pays. Mais il y a un point de renversement dans cette bande. Il se manifeste lorsque Chih-Chien Wang, en hors plan, intervient pour demander à l’un des personnages de poser une question précise à Yushan. Or, Yushan est la compagne de l’artiste. C’est une figure connue pour qui est habitué au travail de l’artiste. On comprend alors que la vidéo est une fiction, créée à partir d’une lettre, elle-même peut-être imaginée aussi, à propos d’une relation qui, elle, est bien réelle.
À cette exposition a succédé The Act of Forgetting, où les signes de facticité sont plus nets. Dans la vidéo géante qui y était projetée, des gens s’installent tour à tour au milieu d’une grande salle. Des techniciens s’y trouvent aussi, pour s’échiner sur le rail qui entoure le centre de la salle et sur lequel glisse un chariot. Ceux qui viennent s’y positionner sont interrogés par l’artiste, que l’on entrevoit parfois et entend indistinctement. Dans cette œuvre, il est sans cesse question de création. Les gens se présentent et parlent de la scène qu’ils joueront, ou non, face à tous, captés par une caméra qui filme en même temps qu’elle tourne en rond. Ils évoquent aussi des expériences personnelles, sans que l’on sache si elles font partie de leur personnage ou non. Certains jouent de la musique, d’autres discutent d’arts, de danse, du jeu d’acteur. Ça se termine par une prestation musicale d’un joueur de santour, auquel se joint tout un groupe.
Les histoires racontées ont ceci de commun d’être uniques et singulières, de celles qui finissent par définir et façonner une personne. Mais ces confessions devant la caméra pourraient bien être des leurres. Rien ne nous dit qu’elles appartiennent véritablement à celui ou celle qui les raconte. Peut-être font-elles partie du jeu… Qu’importe ! Elles sont, elles existent, offertes à tous dans le cadre d’une répétition, qui est autant œuvre en elle-même que préparation à l’œuvre. Depuis, elles sont accessibles à ceux qui peuvent s’en emparer, les reprendre, sans qu’elles perdent de leur force ni de leur impact.
Comme les natures mortes, ces histoires sont fabriquées. Elles forment un assemblage fictionnel dont on ne sait quoi penser quant à leur véracité. Elles aussi ont été lâchées, données, offertes et reprises, à tout le moins par Chih-Chien Wang qui brode sur elles et leur confère épaisseur et dignité. Elles sont à même de prêter humanité à nos existences et de faire, de celui qui s’en repaît, un confesseur, un alter ego, une oreille attentive et compatissante. L’histoire entendue, racontée, pourrait bien être la mienne ou la vôtre, et se rapprocher de quelque circonstance que nous avons vécue.
L’effet du don. Toute cette entreprise de don et de partage me semble aller vers une sorte d’effort existentiel et libérateur. Jacques T. Godbout, chercheur à l’Institut national de la recherche scientifique, ne voit-il pas dans le don une sorte de saut hors de tout déterminisme ? Il permet d’échapper aux prescriptions, vaguement intéressées, du donnant-donnant de l’échange marchand. Il libère l’autre de l’obligation de la contrepartie, du retour sur avance, en quelque sorte. La nature morte est donc parfaitement appropriée comme genre, dans ses principes constitutifs, pour s’intégrer à l’ensemble des travaux de Chih-Chien Wang. Et pour former une image fondamentale de ce qui est en jeu. Dans ses vidéos, par le biais de l’échange et du don d’histoires formatrices des humains, il est question d’échapper à ce qui en elles nous détermine et définit trop étroitement. Raconter ces histoires et les confier à d’autres permet de ne plus subir leur joug. L’expérience de créer, dans cet effort pour rejoindre l’autre et lui demander échange, est une autre façon de sortir, ensemble, de ce qui nous détermine et définit.
Pour l’artiste, cela permet de combler le désir qu’il a de créer « des œuvres qui écoutent ».
1 Charles Sterling, La nature morte de l’Antiquité au XXe siècle, Paris, Macula, 1985.
2 Anne Cauquelin, L’invention du paysage, Paris, Éditions Plon, 1989, 181 p.
3 Les citations proviennent de la page 97 du livre.
4 « A work that listens », lors d’un échange avec l’auteur, le 24 février 2021.
Sylvain Campeau collabore à de nombreuses revues canadiennes et européennes. Il est aussi l’auteur des essais Chambres obscures : photographie et installation, Chantiers de l’image et Imago Lexis, de même que de sept recueils de poésie. Il a aussi dirigé des ouvrages collectifs en arts visuels et en littérature. En tant que commissaire, il a réalisé une quarantaine d’expositions.
[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 117 – DÉCALÉ ]